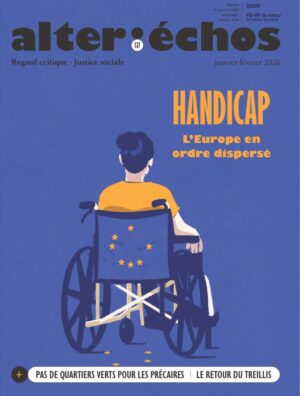À La Bruyère, hameau de Beauvechain, une trentaine de caravanes occupent un carré de pelouse derrière la buvette du terrain de football, près de la base militaire. En cette veille de départ, les machines à laver tournent à plein régime pendant que la lessive sèche sous un soleil de plomb. Etienne Charpentier, couvreur de métier, sort de sa voiture, avance d’un pas assuré. Depuis 2009, il préside le Comité national des gens du voyage, dont il porte la voix depuis des décennies. «On vient ici chaque année depuis vingt ans. Nous sommes le seul groupe à être autorisé. Dans l’ensemble, ça se passe très bien», dit-il, sans donner plus de détails. Par contre, «après, c’est l’aventure. J’attends les réponses d’autres communes».
Installé autour d’un café sous l’auvent de sa caravane, Etienne ne mâche pas ses mots. «Cela fait des années que je m’occupe des problématiques autour de l’accueil des gens du voyage. J’ai cherché des solutions, rencontré des membres du gouvernement. Que des belles paroles, aucun acte.» Il rappelle que la Belgique a maintes fois été pointée du doigt pour ses carences en la matière, notamment par le Comité européen des droits sociaux (CEDS)(1) en 2012. Pourtant, rien ne bouge, ou si peu. À ce jour en Wallonie, seules huit communes sur 262 organisent l’accueil des gens du voyage, dont sept avec le soutien financier de la Région.
Un accueil digne mais coûteux
Côtoyant les roches calcaires, l’ancien camping de Lives-sur-Meuse, niché dans la commune de Namur, a été réaménagé et inauguré en 2015. Ce projet, impulsé dès 2007 par Maxime Prévot, alors échevin des Affaires sociales, poursuivait plusieurs objectifs: «Recevoir dignement les gens du voyage, éviter les installations non autorisées, les dégradations, les raccordements non conformes, mieux gérer les déchets», énumère Jamila Ben Ramdane, référente des gens du voyage pour la Ville de Namur. Pouvant accueillir jusqu’à 16 caravanes et disposant de blocs sanitaires, de machines à laver, d’un accès à l’eau et à l’électricité, de conteneurs, d’un service de conciergerie et d’un local d’animation, cette aire d’accueil est la seule, en Wallonie, à être aussi bien équipée. Mais ces services ont un coût: 80 euros par caravane et par semaine, auxquels il faut ajouter 100 euros de caution. «Cela ne couvre pas toutes les dépenses, c’est une participation aux frais de fonctionnement», indique Aline Walckiers, cheffe de cellule solidarité au service de cohésion sociale.
Pouvant accueillir jusqu’à 16 caravanes et disposant de blocs sanitaires, de machines à laver, d’un accès à l’eau et à l’électricité, de conteneurs, d’un service de conciergerie et d’un local d’animation, cette aire d’accueil est la seule, en Wallonie, à être aussi bien équipée. Mais ces services ont un coût: 80 euros par caravane et par semaine, auxquels il faut ajouter 100 euros de caution.
Les groupes peuvent rester jusqu’à trois semaines, une fois par an, et doivent réserver plusieurs mois à l’avance. Ce terrain n’est cependant ouvert que du 1er mars au 30 octobre, et donc fermé en hiver(2). Une condition requise par les habitants alentour, qui souhaitaient avoir une période de quiétude, lors de la mise en place du projet. À l’époque, l’opposition était vive à cause des craintes nourries de clichés. Mais Jamila l’assure: «Les riverains se sont habitués avec le temps. Parfois, je reçois des appels, toujours pour la même raison: le tapage nocturne. C’est un village calme, avec des personnes âgées, d’autres sont malades ou doivent se lever tôt. Il faut se mettre à la place de tout le monde.» La référente constate aussi «une diminution des occupations en dehors du terrain aménagé». Un résultat qu’elle attribue surtout à «la collaboration mise en œuvre avec la police depuis deux ans».
Un service conditionné
Les conflits générés par les «occupations illicites» des gens du voyage défrayent régulièrement la chronique. Propriétaires et riverains crient leur ras-le-bol, certains bourgmestres expriment ouvertement leur hostilité et procèdent à des expulsions. «Faute d’accueil légal, les pouvoirs locaux nous poussent à nous établir à des endroits qui ne sont pas prévus pour, déplore Etienne Charpentier. Les ennuis surgissent alors, car qui dit campements sauvages dit branchements sauvages (au réseau électrique et de distribution d’eau, NDLR).» Pour pallier ce déficit, la Région wallonne lança, en 2019, un appel à projets afin de financer l’aménagement, l’équipement de terrains ainsi que l’organisation de l’accueil. Mons figurait parmi les cinq communes sélectionnées. «Des gens du voyage venaient toute l’année en grand nombre, parfois sur trois sites différents. C’était difficile à gérer», relate Joseph Marchini, inspecteur principal à la police de Mons-Quévy, en charge des gens du voyage depuis plus de 30 ans. «Le bourgmestre (Nicolas Martin, PS, NDLR) voulait prendre ses responsabilités, mettre un terrain à disposition mais il y a eu une grande opposition», poursuit Bruno Lheureux, chef de corps à Mons-Quévy.
Les conflits générés par les «occupations illicites» des gens du voyage défrayent régulièrement la chronique. Propriétaires et riverains crient leur ras-le-bol, certains bourgmestres expriment ouvertement leur hostilité et procèdent à des expulsions.
Face à cette levée de boucliers, le projet est abandonné fin 2021(3). La police décide malgré tout de reprendre les choses en main et d’adopter une approche «plus conciliante» que la répression pure. Elle propose alors aux gens du voyage de leur mettre à disposition, hiver comme été, un parking grillagé situé aux extrémités de la ville, près du lac du Grand Large, mais surtout loin des habitations, là où «ils ne dérangent personne.» Dans le même temps, les autorités font condamner un autre site, celui où les groupes avaient l’habitude de s’installer, moyennant des blocs de béton et une barrière avec caméra. Ce «service» n’est cependant pas «un droit acquis», insistent les policiers. Il est assorti de plusieurs conditions: occupation à titre précaire (et donc gratuite), durée maximale (trois semaines), réservation, interdiction de s’installer ailleurs. Auquel cas «on agira de manière ferme», prévient Bruno Lheureux. Depuis qu’ils ont passé cet accord, les policiers montois constatent que les gens du voyage «ne vont plus n’importe où et ne sont plus tout le temps-là».
Transformer la législation pour changer les mentalités
Aussi imparfaits soient-ils, ces trois exemples soulignent l’importance de renouer le dialogue, de trouver un terrain d’entente plutôt que de rejeter en bloc. «Les gens du voyage existent, ils viendront toujours, cherchons des solutions», enjoint Joseph Marchini. «Les administrations doivent changer leurs attitudes à l’égard d’une population qui est belge avant même la création de la Belgique et qui a le seul tort d’avoir un habitat différent», assène Ahmed Akim, directeur du Centre de médiation des gens du voyage et des Roms. Cette évolution doit se traduire au niveau des réglementations locales. 241 communes wallonnes sur 261 interdisent, de façon plus ou moins explicite, la présence de caravanes ou le séjour temporaire des gens du voyage, révèle un état des lieux mené par l’asbl(4). «On ne peut pas demander au citoyen d’être plus tolérant que le règlement qu’il est lui-même censé appliquer», fait valoir Ahmed Akim. De même, face au constat que, «depuis cinq législatures, l’approche volontariste est un échec», la politique d’accueil des gens du voyage en Wallonie doit être «beaucoup plus contraignante, ne plus mettre l’accent sur l’incitant financier mais sur l’organisation».
241 communes wallonnes sur 261 interdisent, de façon plus ou moins explicite, la présence de caravanes ou le séjour temporaire des gens du voyage, révèle un état des lieux mené par le Centre de médiation des gens du voyage et des Roms.
Pas forcément besoin de copier le modèle français et sa loi Besson, obligeant les villes de plus de 5.000 habitants à prévoir des aires d’accueil aménagées. «Ce que veulent les gens du voyage, ce sont des autorisations», précise Ahmed. Il développe: «Chaque commune devrait accueillir, selon ses capacités, un à trois groupes par an, deux à trois semaines, sur un terrain de football, une pâture ou un parking. Cette pratique existe déjà, généralisons ce qui fonctionne.» «En été, c’est très simple, on a juste besoin d’un point d’eau, l’accès au courant et un container pour nos déchets ménagers. Cela représente peu d’investissements», abonde Etienne Charpentier.
Pour les grands rassemblements, à caractère festif ou religieux et réunissant plusieurs centaines de caravanes, Ahmed Akim suggère «d’établir une concertation provinciale. Les gouverneurs sont outillés, ils organisent des événements comme des campements de scouts et des festivals, comparables en termes d’activités et de besoins». Ces mesures ne concernent cependant que les séjours temporaires. Or les gens du voyage ne se déplacent pas constamment, leur mode de vie s’articule entre périodes d’itinérance et de fixation. En hiver, parfois toute l’année, certains vivent sur des «terrains familiaux» dont ils sont propriétaires ou qu’ils louent, dans des caravanes, des chalets ou des roulottes. En Wallonie, la plupart de ces terrains ne sont pas en règle. L’un des enjeux est donc de «régulariser la situation de ces familles, en facilitant l’octroi des permis d’urbanisme, sur la base du décret relatif à l’habitat léger(5)», préconise Ahmed Akim.
Mais pour d’autres, celles qui n’ont nulle part où aller, «le plus dur, c’est l’hiver», insiste Etienne Charpentier. «Le fait que rien ne soit prévu installe une incertitude permanente, avec des conséquences psychologiques, familiales et économiques», alerte Ahmed Akim.
En Flandre, une politique d’accueil différente
Contrairement à la Wallonie, la Région flamande a surtout subventionné des terrains résidentiels ou familiaux. Elle en compte actuellement 36, répartis sur tout le territoire et totalisant 543 emplacements (soit 585 familles)(6). Elle dispose aussi de six «aires de transit». Ces dispositifs sont réservés aux gens du voyage flamands, reconnus depuis 2000 comme minorité culturelle ethnique. Mais selon Caritas Vlaanderen, «en raison de l’augmentation du nombre de caravaniers en Flandre et du manque de terrains, la précarité du logement constitue un problème majeur pour ce groupe».
(1) «Pas de politique d’accueil cohérente pour les gens du voyage», La Libre Belgique, 1/8/2012.
(2) Namur n’est donc pas subventionnée par la Région wallonne pour organiser l’accueil des gens du voyage, car l’une des conditions est d’ouvrir l’aire d’accueil toute l’année. Elle le fait sur fonds propres.
(3) Aucun des cinq projets n’a par ailleurs abouti, pour diverses raisons (opposition citoyenne, motif environnemental, soucis financiers…).
(4) «Le séjour temporaire des gens du voyage dans les réglementations communales en Wallonie», publié le 14/7/25 sur le site internet du Centre de médiation des gens du voyage et des Roms.
(5) Adopté le 2 mai 2019, ce décret reconnaît les habitations légères, dont les caravanes et roulottes, selon une série de critères.
(6) Ces données ont été récoltées sur le site gouvernemental «Vivre en Flandre».