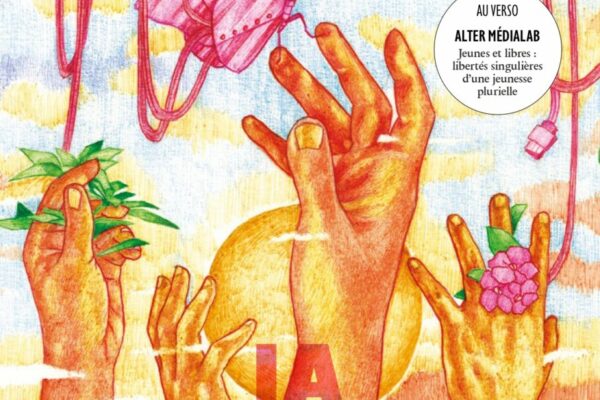Postuler à une offre d’emploi, remplir sa déclaration fiscale ou payer ses factures: de plus en plus de services essentiels sont numérisés et, pour certains, accessibles uniquement en ligne. Une numérisation qui met en péril les droits sociaux pour ceux qui ne bénéficient pas d’accès à Internet ou ne savent tout simplement pas bien l’utiliser. Et ils sont de plus en plus nombreux: 46% des Belges sont en situation de vulnérabilité numérique. C’est l’un des constats qui ressort du Baromètre de l’inclusion numérique publié par la Fondation Roi Baudouin. Laura Faure, chercheuse à l’UCL qui a participé à cette étude, nous explique l’importance de parler des inégalités numériques.
Alter Échos: Le concept de «fracture numérique» a été popularisé dans les années 90 par Bill Clinton. À cette expression souvent employée par les médias, vous préférez parler d’«inclusion numérique». Pourquoi?
Laura Faure: On parle souvent de «fracture numérique» au singulier alors que notre étude et les recherches en général montrent une réalité qui se conjugue au pluriel. On distingue habituellement trois niveaux de fracture: l’accès aux équipements numériques (connexion Internet via un smartphone, un ordinateur ou les deux), les compétences et usages (que fait-on avec cette connexion Internet?) et, enfin, les bénéfices tirés de cet usage (accéder au marché du travail, bénéficier de ses droits sociaux, aux soins de santé, etc.). À ce troisième palier d’inégalité numérique, on parle d’ailleurs de «fracture du 3e degré».
«Si on constate une hausse de l’utilisation des services administratifs en ligne entre 2019 et 2021, elle concerne essentiellement les personnes avec un diplôme de l’enseignement supérieur (90%). Seuls 58% des personnes avec un diplôme secondaire inférieur y ont eu recours. Il y a donc un écart de 30%.»
AÉ: Il ne suffit donc pas d’avoir Internet pour faire partie des «inclus numériques»?
LF: En effet, l’expression de «fracture numérique» alimente un biais d’interprétation. Elle donne l’impression d’une coupure nette entre les personnes qui auraient Internet et celles qui ne l’auraient pas. Implicitement, cela suggère qu’il suffirait d’y donner accès pour ne plus être «fracturé». Or, on observe qu’il y a tout un continuum de difficultés. Ce n’est pas parce qu’on a accès au numérique qu’on parvient à l’utiliser, à en faire un usage dont on pourrait tirer des bénéfices, notamment pour jouir de certains droits sociaux. C’est pour cette raison que je préfère parler d’«inégalités numériques». On vit dans une société où tout se numérise, le travail, les relations sociales, la consommation, et tout le monde ne parvient pas à prendre le train de la numérisation ou ne souhaite tout simplement pas le prendre, ce qui engendre des inégalités inhérentes aux évolutions des nouvelles technologies.
AÉ: La distinction entre l’accès au numérique et les compétences numériques permet en effet de mieux comprendre les écarts qui se creusent au sein de la population belge. 92% des ménages belges bénéficient d’une connexion Internet, mais 46% sont en situation de vulnérabilité, en particulier chez les personnes avec un faible niveau de revenus et de diplômes.
LF: Oui, on peut très bien avoir accès à Internet, mais uniquement via son téléphone par exemple, ce qui complique les choses lorsqu’il s’agit de faire son CV ou remplir sa déclaration fiscale. Lorsqu’on est déjà en difficulté, on va cumuler des déficits de compétences face à cette numérisation galopante. Tandis que les personnes plus à l’aise avec le numérique, qui disposent déjà d’un bon équipement à la maison, d’un certain niveau de compétences pour utiliser les interfaces, vont pouvoir s’emparer plus vite des dernières innovations, plus facilement et de manière autonome. Ce mécanisme est comparable à «l’effet Matthieu», phénomène relatif à la concurrence entre les universités qui décrit comment certains établissements, centres de recherches et scientifiques parviennent toujours à avoir les meilleurs financements. Il y a une sorte d’effet cumulatif.
AÉ: Une distinction qui devient déterminante lorsqu’il s’agit d’exercer certains droits sociaux, dont les services sont massivement en voie de numérisation…
LF: Une des difficultés dans le fait de réduire les écarts, c’est qu’il y a toujours des gens qui font la course en tête, celles bénéficiant de revenus élevés et d’un diplôme du supérieur. Plus il y a du numérique, plus elles en retirent des bénéfices sur le plan économique et social. Prenons l’exemple de la recherche d’emploi. Les meilleures offres d’emploi se trouvent généralement en ligne et les personnes les plus à l’aise avec le numérique vont pouvoir en tirer profit directement. Alors que quand on a un accès qui est contrarié (parce qu’on utilise le wi-fi gratuit dans la rue par exemple), des compétences minimales pour postuler, on perd cet accès aux meilleures offres de job qui pourrait faire évoluer vers de meilleures conditions socio-économiques. C’est un cercle vicieux.
«Une des difficultés dans le fait de réduire les écarts, c’est qu’il y a toujours des gens qui font la course en tête, ceux bénéficiant de revenus élevés et d’un diplôme du supérieur. Plus il y a du numérique, plus elles en retirent des bénéfices sur le plan économique et social. C’est un cercle vicieux.»
AÉ: Chose étonnante, le rapport met en évidence une vulnérabilité numérique chez les jeunes entre 16 et 24 ans.
LF: Lorsqu’ils sont défavorisés ou avec un faible niveau de diplôme, ils sont dix fois plus à n’utiliser qu’un smartphone pour se connecter à Internet, ce qui complique l’accès à certains services administratifs en ligne. Au niveau des compétences, ils ont des usages assez routiniers, consultent les mêmes sites ou applications et peuvent donc se retrouver bloqués face à une démarche en ligne inhabituelle, pour s’inscrire à une formation par exemple. Bien souvent, les jeunes se sont approprié les outils numériques par eux-mêmes, sans avoir été accompagnés, ce qui est encore plus vrai dans les milieux populaires. En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’on est né avec un téléphone dans la main qu’on est forcément plus compétent notamment sur les questions liées aux traces qu’on laisse, l’usage des réseaux sociaux, etc. De manière générale, cette question des compétences est de plus en plus liée au niveau d’éducation, au milieu culturel duquel on est issu.
AÉ: À l’heure où l’on dénonce la connectivité permanente, pourquoi serait-il mauvais d’avoir des usages numériques peu diversifiés?
LF: Si on peut entretenir une position ambivalente par rapport au numérique, il y a toutefois un point sur lequel il faut attirer l’attention. On pourrait se limiter à certains usages dans l’optique d’une certaine sobriété numérique. Mais, dans un contexte où de plus en plus de services essentiels comme l’administratif, la banque ou la santé ne fonctionnent plus qu’en ligne, il peut y avoir des conséquences lourdes sur les accès aux droits sociaux. Ce n’est pas pareil de se déconnecter par choix tout en bénéficiant de moyens économiques ou de compétences pour contourner le numérique, que d’être isolé et de n’avoir que cette possibilité et de ne pas y parvenir. D’où le fait qu’on parle de «vulnérabilités» pour mettre en avant le fait que ce sont des situations subies. Pour preuve: si on constate une hausse de l’utilisation des services administratifs en ligne entre 2019 et 2021, elle concerne essentiellement les personnes avec un diplôme de l’enseignement supérieur (90%). Seuls 58% des personnes avec un diplôme secondaire inférieur y ont eu recours. Il y a donc un écart de 30%. Si la question du revenu reste fondamentale, celle du niveau de diplôme joue un rôle de plus en plus marqué. Tout ce qui se joue au niveau du capital scolaire et de l’éducation tend à avoir une importance dans la proximité avec les démarches administratives.
«Ce n’est pas parce qu’on est né avec un téléphone dans la main qu’on est forcément plus compétent.»
AÉ: Vaut-il mieux continuer d’investir dans le numérique pour le rendre plus inclusif, accessible à tous ou rouvrir plus de guichets pour revenir à des services physiques?
LF: On charge de plus en plus les utilisateurs qui doivent faire eux-mêmes le travail administratif en ligne: télécharger le formulaire, le remplir, le signer, le scanner, l’imprimer, le renvoyer… Les guichets finissent alors par devenir des «helpdesks» où on gère les difficultés numériques.
À chaque publication du Baromètre de l’inclusion numérique, on maintient donc le même message: il est essentiel de repenser à l’utilité d’avoir des services avec un accès physique, qui soient des alternatives offrant la même qualité que les services en ligne. Car bien souvent les services hors ligne bénéficient d’horaires moins larges, de moins de personnel et renvoient les usagers vers Internet. Les services essentiels doivent proposer différents canaux d’accès, numériques et non numériques mis sur le même pied d’égalité. Bien évidemment, il faut aussi rendre le numérique plus accessible, travailler les interfaces pour les rendre plus ergonomiques, plus faciles à comprendre et à utiliser. Sinon le risque serait de laisser le numérique aux personnes qui savent gérer cette complexité-là pour laisser l’alternative aux autres, ce qui créerait un système à deux vitesses. Dans tous les cas, cela ne devrait pas être aux usagers de se former pour atteindre un niveau de digitalisation, d’autant qu’il évolue sans cesse et exige une réactualisation quasi constante. La notion d’inclusion est censée être un mouvement où la société, en l’occurrence ici les services essentiels, s’adaptent à la diversité de leur public.
Baromètre de l’Inclusion numérique, septembre 2022, Fondation Roi Baudouin (https://www.kbs-frb.be/fr/barometre-inclusion-numerique-2022)
En savoir plus
«Transformation numérique: au tour de l’associatif» (dossier), Alter Echos n°496, septembre 2021.