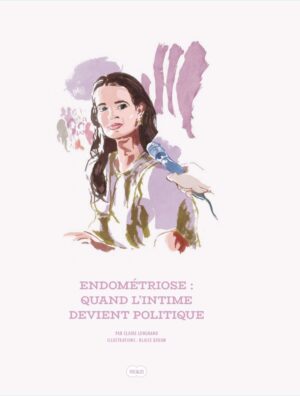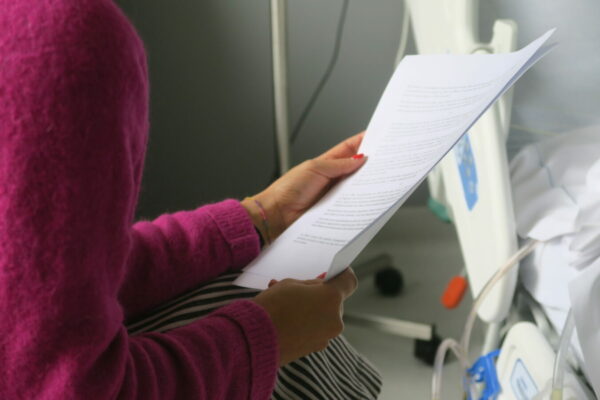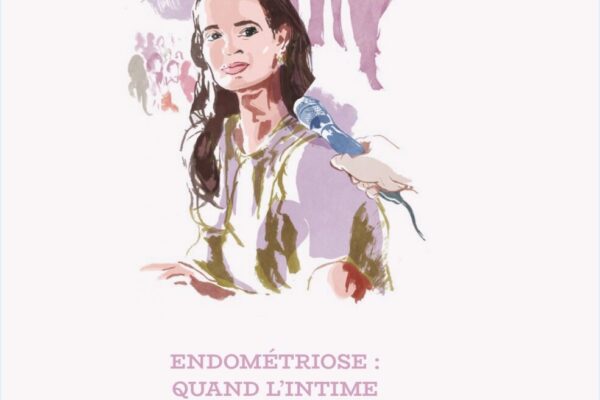Elle est à la retraite depuis peu mais n’aurait pas laissé faire ce travail à quelqu’un d’autre. Quand on la rencontre ce printemps dans les bureaux de Brå, le Conseil national suédois pour la prévention de la criminalité, Stina Holmberg vient de sortir un rapport très attendu en Suède sur «l’application et les conséquences de la loi sur le consentement», cinq ans après la première évaluation sommaire d’une loi longuement attendue elle aussi: la loi sur le consentement, votée en 2018.
«Il ne s’agit pas vraiment de ‘la loi sur le consentement’, précise d’emblée la criminologue et professeure de droit, mais de la modification de l’article 1 du Code criminel. Or, le consentement n’est pas le fondement de la formulation des règles, mais le caractère volontaire d’un rapport sexuel.»
Ce qui signifie qu’il n’est plus nécessaire que l’auteur ait eu recours à la violence, à des menaces ou qu’il ait profité de la situation particulièrement vulnérable de la victime pour pouvoir être coupable de viol. Désormais, il y a viol si la ou le partenaire n’a pas manifesté verbalement ou physiquement son intention d’avoir un rapport.
Parallèlement, une nouvelle qualification pénale du «viol par négligence» a été introduite pour qualifier un «défaut de prudence» dans l’évaluation du risque de non-consentement (donc de viol) de l’autre personne, car, comme le décrit la loi, «le préjudice subi par la victime doit être indépendant du fait que l’infraction soit commise intentionnellement ou par négligence».
Un large consensus politique soutenait la loi: gauche, droite, mouvements féministes, mouvements sociaux. Seuls réfractaires, des juges et des avocat(e)s craignant son caractère trop vague et les risques d’incertitudes juridiques. La loi est aussi régulièrement citée en modèle dans d’autres pays européens qui travaillent à cette question, comme la France très récemment. À raison.
Des effets palpables
À l’issue de ce rapport très fourni, Stina Holmberg considère que la loi fonctionne. Et de l’expliquer par les données. Depuis 2018, les plaintes, les poursuites et les condamnations augmentent. On est passé de moins de 4.000 plaintes en 2015 à plus de 6.000, «signe d’un éveil de conscience aux violences sexuelles, grâce à la loi, mais aussi en lien avec #MeToo», précise-t-elle. D’après Brå, les plaignantes sont maintenant pour moitié des adolescentes, majoritairement dans un contexte où l’agresseur est une connaissance. L’âge médian d’une victime déclarée est de 20 ans (24 auparavant). Ces chiffres viennent donc illustrer la dimension «pédagogique» d’une telle loi.
«C’est formidable de savoir qu’un viol est illégal. Mais s’il n’est pas sanctionné, que disons-nous à la société? Que si vous êtes violée, vous devez vous débrouiller: le gouvernement, la police et la justice ne vous aideront pas…»
Adine Samadi, présidente de Roks, un réseau de 64 refuges pour femmes victimes de violences
Parmi les types de vulnérabilité désormais mieux protégés par la loi, Brå cite les viols dits par «surprise» et les cas où la victime est restée «passive» (en réalité, pétrifiée par la terreur) pendant l’agression. Cela témoigne d’une « bonne » compréhension de la loi et d’un progrès dans la recherche de preuves. Le rapport souligne d’ailleurs que «les preuves orales seules semblent être de plus en plus reconnues comme suffisantes pour une condamnation. La part de toutes les condamnations dans lesquelles il n’y a que des preuves orales a augmenté, passant de 16% en 2017 à 30% en 2023». Le «régime des preuves» reste par ailleurs au cœur des critiques d’une frange d’avocats opposés à la loi. Stina Holmberg évoque des avocats connus qui ont déclaré dans la presse «qu’il y aurait des centaines de jeunes hommes innocents en prison, condamnés pour viol. Ils considèrent que les preuves utilisées en cas de condamnation sont beaucoup trop faibles».
«La société n’a pas suivi»
Des centaines d’innocents peuplant les prisons? D’un autre côté, les victimes, tout comme les organisations de terrain, déplorent que seulement une petite portion des violences sexuelles signalées fasse l’objet de poursuites (13%), et encore moins de condamnations: entre 7 et 10%.
Dans ses bureaux de Roks, sis sur une artère centrale de Stockholm, Adine Samadi gratte le vernis du royaume de l’égalité. Pour la présidente de ce réseau de 64 refuges pour femmes victimes de violences, répartis à travers tout le pays, la loi n’a pas eu l’effet escompté, c’est-à-dire protéger les femmes et les jeunes filles victimes de violences sexuelles, pour une grande majorité d’entre elles dans le cadre de l’intimité du foyer. Il s’agit même pour elle d’un «écran de fumée» sur les structures inégalitaires de la société. «C’est formidable de savoir qu’un viol est illégal, ironise Adine Samadi. Mais s’il n’est pas sanctionné, que disons-nous à la société? Que si vous êtes violée, vous devez vous débrouiller: le gouvernement, la police et la justice ne vous aideront pas…»
«Dans le pays, 90% des atteintes sexuelles ne font toujours pas l’objet d’une plainte et beaucoup de victimes craignent encore la police.»
Cecilia Bödker Pedersen, secrétaire générale de Storasyster
Ida Östensson a beaucoup milité pour la loi sur le consentement, et rappelle l’ambition portée par le projet: améliorer la prise en charge des violences sexuelles par la Justice et protéger l’intégrité physique et sexuelle des femmes. Elle a lu le rapport de Brå avec grande attention, et soutient toujours la loi. Mais, confie celle qui travaille désormais pour ChildX, une association qui lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, «le problème ne réside pas dans la loi, mais dans le fait que le système juridique et la société, encore caractérisés par des conceptions dépassées – en matière d’égalité, NDLR – ne parviennent toujours pas à rendre justice aux personnes vulnérables». «La loi fonctionne, mais la société n’a pas suivi», résumait-elle, aux côtés d’autres associations, dans une carte blanche publiée au lendemain de la sortie du rapport.
Parmi les signataires, Storasyster, qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles. «La loi ne doit pas changer, considère sa secrétaire générale Cecilia Bödker Pedersen, rencontrée dans les locaux sécurisés de l’organisation, mais il faut plus de ressources pour qu’elle soit appliquée.» Storasyster a observé que les femmes qui se présentent à l’association sont aujourd’hui plus nombreuses à porter plainte («#MeToo est aussi passé par là»), mais restent une minorité. «Dans le pays, 90% des atteintes sexuelles ne font toujours pas l’objet d’une plainte et beaucoup de victimes craignent encore la police», explique-t-elle. Parmi les 2.500 personnes, principalement des femmes, que l’organisation soutient chaque année, nombreuses sont celles qui ne savent pas qu’elles ont été victimes de violence sexuelle ou continuent à penser que ce n’est pas important», poursuit la secrétaire générale de Storasyster.
Le viol par négligence, à oublier?
Il ressort de plusieurs enquêtes menées sur le terrain que la marge d’interprétation des juges sur le caractère «volontaire», qui n’ont pas toutes et tous une grille de lecture féministe de la loi, reste encore trop large. Cela se marque particulièrement dans les affaires de «viol par négligence», ce viol «non intentionnel», en quelque sorte, passible d’une peine de prison plus légère – 10 mois contre 37 mois pour les autres. «Une législation favorable aux hommes plutôt que protectrice des femmes et des victimes», considère Roks.
«Pour diminuer les viols en Suède, il faut changer les normes, et nous avons du travail.»
Ida Östensson, militante pour la loi sur le consentement
«Nous pensions qu’il pourrait être plus facile de prouver que l’agresseur a fait preuve d’insouciance plutôt que d’avoir eu l’intention de violer, qu’il n’avait pas pleinement compris», rappelle Stina Homlberg. Un objectif raté: il se révèle inopérant sur le terrain, et même contre-productif. Brå a pu constater «que dans plusieurs condamnations pour viol par négligence, on pouvait se demander s’il n’aurait pas plutôt fallu retenir la qualification de viol, ou ne pas engager de poursuites du tout».
Changer les normes
«Pour diminuer les viols en Suède, il faut changer les normes, et nous avons du travail», relate Ida Östensson, s’inquiétant tant de l’augmentation du porno chez les jeunes que de la «normalisation croissante de la commercialisation du corps des jeunes filles.» Un tournant préoccupant dans un pays connu pour sa loi de 1999, unique au monde, pénalisant l’achat de services sexuels.
«Dans les refuges, nous hébergeons des femmes qui pensent qu’elles doivent accepter d’être étranglées ou battues pendant les rapports sexuels, que c’est normal. Elles ne disent pas non parce qu’elles pensent qu’elles sont censées consentir à ce type d’acte», souligne Adine Samadi.
L’association Storasyster rapporte aussi un sentiment de honte que la loi sur le consentement n’a pas fait disparaître. «L’une des questions que nous posons aux femmes lorsqu’elles nous contactent est la suivante: ‘Avez-vous eu honte?’ On a eu 100% de oui. Ce sont encore les femmes qui ont honte des violences sexuelles. ‘Je n’aurais pas dû rentrer à la maison avec lui, je n’aurais pas dû boire autant, sourire et flirter.’ C’est tout le changement auquel nous devons travailler: les femmes devraient absolument pouvoir vivre pleinement leur vie sans avoir à s’inquiéter ou à assumer la responsabilité lorsque quelqu’un décide de commettre un crime.» Et pour voir advenir ce changement, il faudra renforcer le «caractère volontaire» de la société tout entière.
L’Europe du consentement
Les pays européens peuvent être classés selon quatre grandes catégories de définition du viol.
1°) C’est un viol si la victime n’a pas donné son accord de façon explicite (Espagne, Suède).
2°) C’est un viol si la victime a montré son non-consentement, même sans dire mot (la Belgique, par exemple. La France s’apprête à adopter cette vision). Il y a des conditions prévues par la loi [non exhaustives] dans lesquelles le consentement pourrait ne pas être valide.
3°) C’est un viol s’il y a eu usage de «violence, contrainte, menace ou surprise» (France, définition en vigueur actuellement; Belgique, ancienne définition…).
4°) C’est un viol s’il y a eu usage de contrainte ou de violence physique (Hongrie, Croatie…).
Depuis 2011, la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique) demande aux États d’intégrer le concept d’actes sexuels «non consentis» à leur arsenal législatif réprimant les violences sexuelles. La Belgique l’a ratifiée en 2016.
Au sein de l’Union européenne, la directive commune sur les violences faites aux femmes (février 2024) n’intègre pas de définition commune du viol: la France et d’autres pays (Hongrie, Slovaquie, République tchèque, notamment) s’y sont opposés.
Cet article fait partie d’une enquête réalisée par Véronique Laurent, Manon Legrand, Sabine Panet et Nolwenn Weiler en France, Belgique et Suède, soutenue par Investigative Journalism in Europe (IJ4EU) et publiée dans Basta! (France), axelle magazine et Alter Échos (Belgique).