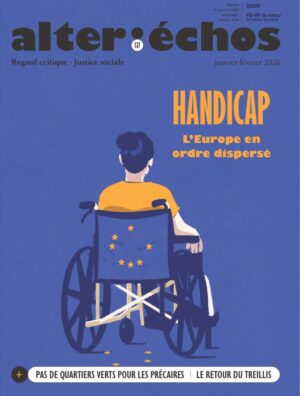Le 17 juillet 2025, le ministre de l’Économie et de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet, présentait sa réforme des cellules de reconversion, dispositif unique en Belgique pour accompagner les licenciés collectifs. L’objectif affiché par le ministre MR? «Conjuguer efficacité, anticipation et responsabilité sociale dans la gestion des restructurations, tout en préservant l’expertise de chacun», pour épauler les travailleurs «face à l’épreuve», avec la promesse «d’un retour rapide à l’emploi.»
En substance, le projet prévoit une intervention plus précoce du Forem, en collaboration avec les syndicats, afin de préparer le terrain dès l’annonce d’un licenciement collectif. L’idée est d’agir avant que celui-ci ne devienne effectif, afin de réduire les périodes de chômage. Le texte confirme le rôle du service public de l’emploi dans le cadre des cellules pour l’emploi, mais le positionne désormais comme coordinateur central, chargé de diriger ces cellules et d’encadrer les opérateurs d’outplacement, là où il n’était auparavant qu’opérateur aux côtés des cellules de reconversion. Les syndicats, pour leur part, se voient cantonnés à cette nouvelle phase d’accompagnement anticipé.
Officiellement, le gouvernement affirme vouloir garantir un accès égal aux services de reconversion pour tous les travailleurs. À première vue, la proposition semble équilibrée, ménageant la chèvre et le chou. Toutefois, les réactions des différents acteurs concernés se sont révélées plutôt contrastées.
En substance, le projet prévoit une intervention plus précoce du Forem, en collaboration avec les syndicats, afin de préparer le terrain dès l’annonce d’un licenciement collectif. L’idée est d’agir avant que celui-ci ne devienne effectif, afin de réduire les périodes de chômage.
Federgon, la Fédération des opérateurs privés de l’emploi, a immédiatement salué l’annonce et plaidé pour appliquer le modèle flamand et bruxellois en Wallonie. «Le secteur de l’outplacement a montré depuis de nombreuses années qu’il pouvait faire face à la situation sur le marché du travail, tant lors d’un licenciement collectif que lors d’un licenciement individuel»(1), a rappelé dans un communiqué Thierry Devillez, le directeur Wallonie-Bruxelles de Federgon, soulignant un taux de réinsertion record de 64,6% en 2024 après six mois d’accompagnement.
Au contraire des syndicats, où l’enthousiasme était plus modéré face aux annonces du gouvernement wallon. Selon ces derniers, les «fake news» propagées par les libéraux, s’appuyant sur des chiffres erronés et «un écran de fumée des statistiques», dissimulent au fond un projet clair et limpide: «La volonté du ministre Jeholet est de marchandiser le secteur et de limiter l’intervention des syndicats et des services publics, sous couvert d’une recherche de plus grande efficacité», analyse Renaud Bierlaire, coordinateur des cellules de reconversion pour la FGTB.
Ce syndicaliste, engagé de longue date dans l’éducation populaire, rappelle l’origine de la grogne des opérateurs privés: l’arrêté fédéral de 2006 en lien avec le Pacte des générations, qui a intégré les cellules de reconversion dans le dispositif fédéral de cellule pour l’emploi, les légitimant comme organismes de référence lors de licenciements collectifs en Wallonie.
«Évidemment, ça a fortement contrarié les boîtes de placement privées, parce que nous, en tant que service public, nous étions ‘gratuits’ pour les entreprises. Nous avions, en outre, une longueur d’avance, puisque nous étions dans le paysage de l’accompagnement des reconversions depuis le milieu des années 70, alors qu’à cette époque l’outplacement privé était quasi inexistant, surtout en dehors des profils de cadres supérieurs. En clair, on leur a bloqué le marché», souffle-t-il.
Fin d’un quasi-monopole
Certes, la proposition de Jeholet n’abroge pas le décret wallon de 2004(2) qui institutionnalise les cellules de reconversion. «Mais il abroge tous les articles qui donnent des moyens au Forem et aux organisations syndicales pour accompagner les personnes vers l’emploi et pour la formation, et il confie cette partie de plan d’accompagnement et de formation aux boîtes d’outplacement privées», explique-t-il, pointant la proximité de certains collaborateurs du ministre avec le secteur privé du placement.
Pour comprendre l’architecture de la réforme, il faut revenir à un pilier du droit social belge: la loi Renault. Adoptée à la fin des années 1990, après le licenciement collectif de l’usine Renault à Vilvorde, elle prévoit deux étapes. D’abord, une phase de consultation ouverte, où syndicats et employeurs échangent et explorent des alternatives. Ensuite, une phase de négociation d’au moins trente jours, renouvelable une fois, destinée à fixer le plan social: indemnités, cellule de reconversion, etc.
Ce n’est qu’ensuite que viennent la notification des licenciements et leur mise en œuvre. C’est sur ce terrain que s’inscrit la réforme libérale: les prestations de suivi passeraient désormais entièrement aux mains d’opérateurs privés, mettant fin aux cellules de reconversion. Les syndicats, eux, conserveraient un rôle encore flou, mais limité, dans la nouvelle phase d’accompagnement anticipé.
Un dispositif vieux de près d’un demi-siècle
Pour saisir l’ampleur de la réforme, il faut se plonger dans l’histoire mouvementée de la Wallonie, et notamment de sa désindustrialisation galopante. Les cellules de reconversion naissent en 1977, après la fermeture de l’usine sidérurgique d’Athus. À l’époque, c’était un dispositif informel: un local installé près du site pour accueillir les travailleurs licenciés. «C’était innovant, et surtout, il n’existait rien pour répondre à ces chocs qui bouleversaient toute une région», rappelle Frédéric Naedenoen, de l’Université de Liège.
Les choses se sont accélérées au tournant du millénaire avec la faillite de la Sabena, en 2001, qui a entraîné le licenciement de milliers de travailleurs wallons. Des antennes de longue durée sont alors mises en place. Peu après, en 2004, un décret instituait officiellement les cellules de reconversion en Wallonie et consacrait leur financement public.
Une première brèche vers le privé s’est ouverte fin 2005 avec le Pacte de solidarité entre les générations du gouvernement Verhofstadt II. Celui-ci impose la création d’une cellule pour l’emploi en cas de licenciement collectif et rend obligatoire l’outplacement pour les plus de 45 ans, offrant ainsi une porte d’entrée aux opérateurs privés.
Depuis lors, les Régions ont divergé: la Flandre et Bruxelles ont misé sur le privé, tandis que la Wallonie, marquée par la désindustrialisation, a consolidé son modèle public et partenarial. Ces choix ont produit des résultats contrastés: Pierre-Yves Jeholet a dénoncé ainsi un taux de réinsertion en baisse en Wallonie, à 56,5% l’an dernier, contre environ 73% via l’outplacement privé en Flandre.
Des données biaisées?
«Les chiffres flamands mobilisés par le ministre sont meilleurs que ceux wallons, mais cela tient moins à l’efficacité des opérateurs qu’aux dynamiques du marché de l’emploi, nuance Renaud Bierlaire. Le 8 septembre, le VDAB affichait 230.000 offres d’emploi, contre seulement 39.000 sur le site du Forem. Résultat: il y a six fois plus d’offres en Flandre… et 50.000 chômeurs de moins.»
Frédéric Naedenoen met aussi en garde contre une lecture tronquée se référant à une enquête de terrain qu’il avait réalisée il y a plusieurs années. «À l’époque de mon étude, les licenciés étaient parfois répartis entre cellules de reconversion et cellules privées pour l’emploi, rappelle-t-il. Or, il est arrivé que les opérateurs privés tentent de faire de l’écrémage, en remettant par exemple une offre de service pour les seuls employés, ce qui renvoyait les ouvriers vers le Forem. Les résultats étaient donc biaisés: on ne peut pas comparer des pommes et des poires.» Autrement dit, les boîtes intérimaires se gardaient les profils les plus simples à placer.
Une première brèche vers le privé s’est ouverte fin 2005 avec le Pacte de solidarité entre les générations du gouvernement Verhofstadt II. Celui-ci impose la création d’une cellule pour l’emploi en cas de licenciement collectif et rend obligatoire l’outplacement pour les plus de 45 ans, offrant ainsi une porte d’entrée aux opérateurs privés.
En outre, «à l’époque, qu’elles soient publiques ou privées, les cellules proposaient leurs propres méthodes de calcul de leurs résultats». Chacun mettait en avant ses résultats, sans réelle comparabilité. Le Forem affichait par exemple 75 à 80% de réussite, mais sans distinguer les retours directs à l’emploi des parcours réellement accompagnés. Nombre de travailleurs proches du marché attendaient logiquement la prime avant de repartir, tandis que les agences d’intérim ne favorisaient pas les formations longues, selon lui. Et de conclure qu’«il faudrait une méthode de calcul standardisée».
La quantité au détriment de la qualité
Au-delà des considérations purement quantitatives, l’autre point est celui de la qualité de l’accompagnement. Ainsi, aux yeux de Naedenoen, les cellules de reconversion présenteraient de nombreux avantages, notamment celui de garder un collectif en restant à proximité de l’usine et en passant par les délégués syndicaux, connus des travailleurs. «La présence d’un délégué de confiance chargé et rémunéré pour faire le lien entre eux et l’administration wallonne, tout en connaissant leur parcours personnel, était perçue comme un atout majeur par les travailleurs», nous raconte l’universitaire.
Surtout, selon lui, l’essentiel reste le temps offert par les cellules de reconversion: un an. «Permettre au travailleur de vivre son deuil puis de chercher un emploi correspondant à ses attentes apporte des avantages psychologiques indéniables», explique-t-il. Et d’ajouter que plus de temps et un meilleur accompagnement tendent à déboucher sur un emploi plus durable. Même si d’autres études montrent qu’un retour rapide à l’emploi réduit le risque d’un chômage de longue durée, nuance-t-il.
«Le ministre Jeholet présente sa réforme comme un service plus qualitatif, plus dynamique et centré sur l’individu. Mais alors, il ne doit surtout pas proposer l’outplacement», lance, provocateur, Renaud Bierlaire. Pour étayer son propos, il rappelle que l’outplacement se limite à 30 heures sur trois mois pour les moins de 45 ans, et 60 heures sur six mois pour les plus de 45 ans(3). «Nous, on est ouverts cinq jours sur cinq pendant un an. Trente pour cent de notre public suit une formation, la moitié a plus de 50 ans, et notre taux d’insertion moyen atteint 68% sur vingt ans, avec une majorité de personnes sans certificat d’enseignement secondaire supérieur.»
Plus de temps et un meilleur accompagnement tendent à déboucher sur un emploi plus durable. Même si d’autres études montrent qu’un retour rapide à l’emploi réduit le risque d’un chômage de longue durée, nuance Frédéric Naedenoen.
Autre enjeu majeur: la réforme pourrait rogner directement les indemnités des travailleurs. «Dans une entreprise en difficulté, un outplacement privé coûte entre 1.800 euros pour un ouvrier et 6.000 euros pour un cadre», détaille le syndicaliste. Lorsqu’il s’agit de dizaines de salariés, ces montants grignotent aussitôt l’enveloppe négociée par les syndicats pour les primes de départ ou la formation. «Aujourd’hui, la reconversion est financée par le public, ce qui laisse plus de marge pour obtenir des indemnités décentes, des budgets formation, etc.»
Tout n’est pas parfait, admet le syndicaliste, évoquant notamment les lacunes dans la validation des compétences qui auraient pu être améliorées dans une évaluation comme annoncé dans la déclaration de politique générale. Frédéric Naedenoen souligne, quant à lui, plusieurs faiblesses: la permanence de certaines antennes, qui ne sont pas liées à une restructuration d’entreprise en particulier, qui éloigne le dispositif des travailleurs et dépersonnalise le suivi; la rigidité des programmes de suivi des travailleurs fixés par décret; une communication perfectible; et, bien sûr, un coût global élevé.
L’avant-projet de décret est passé en première lecture en juillet dernier(4) et devrait être adopté en deuxième lecture dans le courant du mois d’octobre. Peu de chances d’ici là que le gouvernement wallon fasse volte-face ou vienne amender sa proposition, mettant fin à une pratique d’accompagnement partenarial et syndicale vieille de quarante ans.
Note de la rédaction: Ni le cabinet du ministre Jeholet ni Federgon, la Fédération des opérateurs privés de l’emploi, n’ont souhaité répondre à nos questions et nous ont renvoyés vers leurs communiqués de presse.
(1) https://federgon.be/persbericht/news/loutplacement-est-le-bon-outil-au-bon-moment/
(2) https://reconversionscsc.be/index.php/reglementations/#:~:text=Les%20grandes%20%C3%A9volutions%20des%20r%C3%A9glementations,accompagnateurs%20sociaux%20permanents%20(ASP)
(3) https://www.acerta.be/fr/employeurs/licenciement-de-travailleurs/reclassement-professionnel
(4) https://www.wallonie.be/sites/default/files/2025-07/17juillet20250800-ordredujour-1.pdf