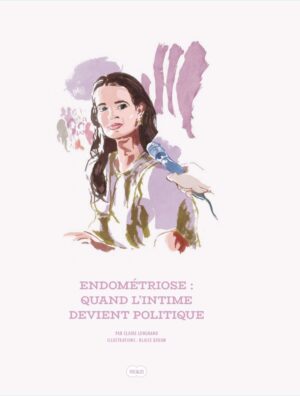Dans huit pays dans le monde, des salles de consommation permettent aux usagers de consommer leurs propres produits dans de bonnes conditions d’hygiène, sous la surveillance d’un personnel qualifié et sans crainte de se faire épingler par la police. Evaluées positivement, ces expérimentations demeurent controversées par leur poids idéologique
Dans l’Europe des années ’80, la consommation en rue d’héroïne et de cocaïne augmente, de même que les nuisances publiques qui y sont associées. Simultanément, la contamination par le virus HIV explose. Aux Pays-Bas, les autorités locales cherchent des solutions. On y opte pour une approche pragmatique, retrace Cédric Charvet1, coordinateur d’une des cinq salles de consommation d’Amsterdam : « Des comités se mettent en place, rassemblant politiques locaux, acteurs de la santé et du social, et consommateurs. Ils décident d’ouvrir des structures pour les usagers qui n’ont pas de lieu où consommer, principalement des sans-abri. » Les salles de consommation ne seront officiellement reconnues qu’en 1998, mais des pratiques underground, dans des squats notamment, sont déjà expérimentées. Mêmes types de processus en Suisse et en Allemagne, autres pays précurseurs.
La plupart des projets de réduction des risques naissent de manière underground, explique Catherine Van Huyck, directrice de Modus Vivendi2. Comptoirs d’échange de seringues, programmes de substitution à la méthadone ou salles de consommation, ils mettent souvent une dizaine d’années à être cautionnés par les pouvoirs publics. Ces derniers étant généralement davantage préoccupés par leurs effets positifs en termes de réduction des nuisances publiques : car les consommateurs qui s’injectent dans un parc ou dans l’entrée d’un immeuble, et qui y abandonnent leurs seringues, alimentent le sentiment d’insécurité. Voire une petite insécurité, réelle celle-là, liée à l’acquisition de ces drogues.
Une reconnaissance légale qui peut se révéler un réel parcours du combattant. Celle de la salle d’injection supervisée Insite, à Vancouver (Canada), a fait l’objet d’une énorme bataille juridique. Depuis 2003, le projet obtenait dérogation sur dérogation pour pouvoir fonctionner légalement. En 2008, les Conservateurs annoncent qu’ils ne renouvelleront pas l’exemption. Dénouement final : septembre 2011, la Cour suprême du Canada se prononce pour le maintien du projet, au nom du droit fondamental à l’accès à des services de santé, et parce que la décision de fermeture de la salle met la vie des consommateurs en danger.
A l’heure actuelle, plus de 90 salles de consommation sont actives dans le monde : 12 en Suisse, 45 aux Pays-Bas, 25 en Allemagne, 6 en Espagne, 1 en Australie, 1 au Canada, 1 au Luxembourg, 1 en Norvège.
Depuis quinze ans, il existe aux Pays-Bas des flux migratoires de consommateurs, qui varient selon les politiques nationales en matière de drogues. L’Allemagne, la Suisse et la Hollande ont été les premiers pays à ouvrir des salles de consommation. « Cela a attiré des consommateurs à venir s’y installer. Des consommateurs qui préféraient vivre en étant sans-abri, mais en ayant accès à ces salles plutôt que de se retrouver en prison dans leur pays », explique Cédric Charvet. Dès que des salles de consommation s’ouvrent dans leur pays d’origine ou que les services socio-sanitaires destinés à ces publics s’améliorent, ils regagnent leur contrée. Plusieurs vagues d’immigration se sont ainsi succédé à Amsterdam : des Italiens, Anglais et Espagnols d’abord, des personnes issues des pays de l’Est ensuite, et des Lituaniens, Estoniens, Grecs, Roumains et Italiens aujourd’hui.
Hygiénisme vs inclusion sociale
Avec un accès à bas seuil (pas d’obligation de sevrage, services gratuits et souvent anonymes), les salles de consommation visent les usagers de drogues les plus marginalisés, souvent désaffiliés des services sociaux et médicaux. Ces personnes peuvent y venir pour s’injecter (parfois pour inhaler ou fumer) dans un cadre sécurisé. Trois maîtres mots pour caractériser ces dispositifs : l’hygiène (matériel stérile), la sécurité (les injections sont supervisées, un dispositif de premiers soins et d’appel des secours est prévu) et un environnement sans stress (l’usager est dans un espace d’exception où il est légalement protégé).
« Il existe des salles plus médicales, d’autres plus sociales, dépeint Cédric Charvet. Dans les salles de type plus médical, le consommateur vient, s’injecte, puis s’en va. Chez nous, les gens peuvent interagir avec les autres, se faire un shoot, lire le journal, puis se refaire un shoot. Il y a une télévision, s’ils veulent regarder un match de foot, pourquoi pas ? Nous essayons de rendre le cadre convivial… » Ici on travaille dans le non-jugement, en acceptant le consommateur tel qu’il est, comme une personne à part entière, qui peut travailler, aimer le foot, avoir des enfants… « La bouteille est souvent à moitié pleine, explique le coordinateur. On essaie de développer l’estime de soi, car plus cette estime est importante, plus il y aura un désir de changement, une réflexion pour sortir de la spirale de la rue. » L’accent est mis sur le lien social et l’accompagnement des usagers.
Un maillon de la chaîne
Toutes ces expérimentations ont été évaluées, réévaluées. Les pouvoirs publics, en bons gestionnaires, sont en demande de résultats « evidence-based ». Ils veulent du chiffre. Mais même en ne prenant en compte que des critères considérés comme objectifs, de nombreuses études3 convergent pour dire que ces expériences sont positives. Les nuisances publiques sont réduites, de même que le nombre d’overdoses dans les quartiers avoisinants, et la santé sociale et sanitaire du public cible s’améliore : meilleures pratiques d’injection, réduction des infections aux virus HIV et de l’hépatite C, réduction des lésions, meilleur accès aux soins et reprise de contact avec un public difficile d’accès.
Une étude de Vancouver a même démontré que ces salles seraient un bénéfice pour la société (notamment en termes de soins épargnés par la sécurité sociale), 5,12 fois plus élevé que leur coût. Ce chiffre ayant été calculé sur base des projections les plus pessimistes.
« Mais ces salles ne sont pas une solution miracle, précise Miguel Rwubu, d’Eurotox4. Elles sont un dispositif parmi d’autres, elles touchent une population résiduelle pour laquelle les autres dispositifs n’ont pas été efficaces et qui est exclue des centres de soins. » Elles sont un maillon de la chaîne, qui va de la prévention aux soins.
« Autre chose, ajoute-t-il, si on considère que l’abstinence est la seule solution pour ces consommateurs, ou si l’objectif est de lutter contre les drogues, alors les résultats sont peu probants. » Et c’est bien là que le bât blesse. Car malgré le caractère positif des évaluations menées, les salles de consommation font encore souvent l’objet de controverses animées.
L’abstinence en débat
Avec ces « salles de shoot », comme elles sont péjorativement appelées par leurs détracteurs, la consommation de drogues serait banalisée, voire encouragée. L’entrée des consommateurs dans un parcours de sevrage serait aussi retardée. « Il y a un gros tabou autour de l’abstinence, nous dit Catherine Van Huyck. Le discours est très manichéen. Les consommateurs sont considérés comme des malades, qu’il faut absolument sortir de « l’esclavage » ». Or non seulement la majorité des consommations sont en fait gérées, mais il serait surtout utopique d’espérer atteindre une société « sans drogues ». « D’ailleurs, le type de politique adopté, qu’il soit plus répressif ou au contraire plus libéral, n’influence pas le volume des consommations, explicite Miguel Rwubu. L’enjeu est donc bien d’avoir un corps social socialement « sain » [NDLR dans le sens communautaire du terme, de bien-être] et plus inclusif. »
D’où la nécessité, pour Fabrice Olivet, directeur d’ASUD (Autosupport et réduction des risques parmi les usagers d
e drogues, France)5 d’aller vers une dépénalisation de l’usage des drogues ainsi qu’une prise en charge sanitaire plus volontariste. « Car même avec des salles de consommation, on opère dans une espèce de schizophrénie, explique-t-il : on tolère la consommation dans un périmètre donné et, au-delà de cela, c’est la répression. » Encore faudrait-il que l’opinion publique et le politique décident de ne pas faire de ces publics des laissés pour compte de plus et que les restrictions budgétaires actuelles ne ciblent pas prioritairement ce secteur quelque peu mal-aimé.
Le 5 février dernier, le gouvernement français de Jean-Marc Ayrault a donné son accord pour l’ouverture d’une salle de consommation supervisée à Paris. Une première en France. Mais le débat n’est pas neuf. « Il s’est posé dès le démarrage de la politique de RdR dans les années ’90, nous explique Fabrice Olivet. Une première salle de consommation pour des produits légaux avait déjà été expérimentée en 1995 par les militants d’ASUD à Montpellier, mais l’expérience s’était mal terminée, par une overdose, non mortelle heureusement. »
Depuis lors, le débat revient régulièrement sur la table. Un débat très polarisé « gauche/droite » (même si plusieurs politiques de droite se sont montrés favorables à l’introduction de ces projets, dont Roselyne Bachelot, ministre de la Santé entre 2007 et 2010, ainsi que plusieurs maires UMP), mais aussi au sein du corps médical lui-même. « Depuis que la RdR est officialisée en France, en 2004, il y a eu un changement de paradigme chez les professionnels de la toxicomanie, qui se montrent aujourd’hui favorables à de telles expérimentations. Mais chez les médecins, dans leur partie la plus réactionnaire, il reste beaucoup d’opposition. »
Le projet parisien devrait voir le jour courant 2013. Pour le directeur d’ASUD, l’ouverture de cette salle est un signal fort. « Mais il faut ramener cet événement à sa juste proportion, explique-t-il. La salle va viser quelques dizaines d’usagers très précarisés, mais ne va pas changer la question de la prise en charge des addictions en France… »
1. DeRegenboog Groep–AMOC :
– adresse : Stadhouderskade, 159 à 1074 BC Amsterdam (Pays-Bas)
– tél. : 0031 20 531 76 00
– courriel : info@deregenboog.org
– site : www.deregenboog.org
2. Modus Vivendi :
– adresse : rue Jourdan, 151 à 1060 Bruxelles
– tél. : 02 644 22 00
– courriel : modus@ modusvivendi-be.org
– site : http://www.modusvivendi-be.org
3. Notamment de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, de l’Institut de santé publique du Québec et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (France). Une synthèse de ces évaluations est disponible sur le site d’Eurotox : Rwubu M., « Dossier : Les salles d’injection supervisées – Tiré à part du rapport sur l’usage des drogues en Fédération Wallonie-Bruxelles 2011-2012 », Eurotox, Bruxelles, 2012.
4. Eurotox :
– adresse : rue Jourdan, 151 à 1060 Bruxelles
– tél. : 02 539 48 29
– courriel : info@eurotox.org
– site : http://www.eurotox.org
5. Autosupport et réduction des risques parmi les usagers de drogues (ASUD) :
– adresse : rue Vitruve, 32 à 75020 Paris (France)
– tél. : 0033 1 43 15 04 00
– courriel : contact@asud.org
– site : http://www.asud.org