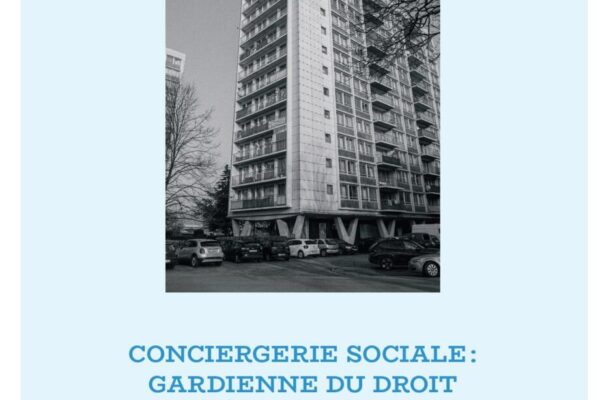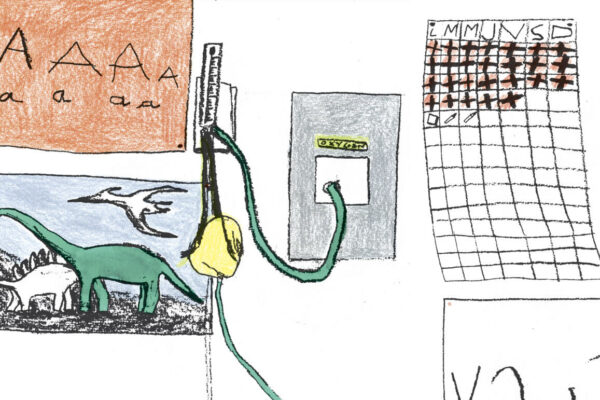Grâce à Facebook et au bouche-à-oreille, les soutiens affluent, de l’argent arrive. Des investissements plus importants deviennent possibles: des tentes plus spacieuses et de meilleure qualité, des réchauds avec de petites bonbonnes pour cuisiner de façon autonome. Début juillet, la distribution de repas ralentit, remplacée par des colis d’invendus et de dons. «On a fait des appels pour des casseroles: ‘Vous êtes confinés? Rangez vos armoires et amenez-nous tout ce que vous n’utilisez pas!’» Le rythme change, mais les questions pleuvent. On arrête? On continue? Comment? C’est compliqué. «On s’est attaché, reconnaît Sophie Bodarwé. Il y a le côté affectif et social, des liens de confiance. On les lâche, et quoi? On va continuer à passer à côté d’eux comme si de rien n’était?»
Parmi les sans-abri se croisent différents profils. De vieux migrants – russe comme Paul*, nord-africain comme Sergio* ou sri-lankais comme Sheeva* –, en Belgique depuis quinze ou vingt ans, dont les chances de régularisation sont pratiquement nulles et dont ce n’est d’ailleurs pas l’unique souci. Des jeunes avec de gros problèmes d’addiction ou de santé, comme Kevin* et Christophe. Des couples improbables comme celui que forment Claire* et Johnny*. Des femmes seules aussi, comme Virginie. C’est à ce moment-là que le service de santé mentale de Seraing prend contact avec le collectif. Les assistantes sociales sont prêtes à donner du temps pour accompagner ces personnes dans leurs diverses démarches. Grâce à leur intervention, Christophe a pu renouer un contact avec sa famille. «On s’est dit qu’on tenait là quelque chose, et qu’on irait plus loin. L’idée de Sortir du bois est née: on allait les aider à trouver un logement», poursuit Sophie Bodarwé.
Le plan A, c’était de constituer des cautions pour faciliter leur accès à la location. Un peu suivant le modèle du Housing First, un toit à soi favorisant les autres étapes d’une réinsertion. Avec la vente de sweat-shirts, de bonnets et de sacs à dos frappés du logo de Sortir du bois – une brouette rappelant les innombrables livraisons de vivres dans les coteaux –, quelques milliers d’euros ont été collectés. «On approchait de la fin de l’année, il commençait à faire froid, on pensait à des tiny houses… Puis on s’est rendu compte que certains sans-abri n’étaient pas prêts pour une location et qu’une forme de transition était nécessaire.» Le plan B, ce fut d’acheter une caravane, et Sheeva a été le premier à en bénéficier. «Sheeva avait une santé déplorable et se nourrissait plus de Gordon que d’autres choses… Un jour il a été emmené d’urgence à l’hôpital et il n’était pas vraiment question qu’il regagne sa tente à la sortie pour qu’on le voie replonger», raconte Sophie Bodarwé. À Nandrin, une jeune hébergeuse de migrants en transit a accepté d’accueillir la roulotte sur son terrain et de veiller sur lui comme elle le fait pour ses hôtes de passage. «Si je le fais, dit-elle, c’est aussi pour donner à d’autres l’envie de le faire.»
Toujours grâce aux dons et aux appels sur le Net, il y a aujourd’hui huit caravanes disponibles. Sophie Bodarwé n’en revient toujours pas: «Tu dis que tu en cherches et on t’en offre!»
Johnny, Claire et leur chat Lilou sont installés depuis deux mois à Herstal, sur le site réaffecté des anciennes usines ACEC. À une vingtaine de mètres d’eux, on retrouve Kevin. Stéphane Riga leur apporte à chacun un énorme sac: des provisions, des habits et des cosmétiques pour Claire. Elle lève un pouce, ravie. «À l’aise. Sophie, elle assure comme d’hab!», dit-elle.
« On est arrivé ici après l’accident de Johnny, il a passé trois mois dans le coma. On avait tout, on a tout perdu. L’appartement, l’immeuble a été vendu. Il fallait se reloger, on n’avait pas de sous. On avait encore la voiture, on a dormi dedans. Puis sous tente, d’un endroit à l’autre. Bam-bam-bam-bam… On avait tout. » Claire
Elle s’excuse, car elle vient de se réveiller, les médicaments pour l’aider à arrêter la boisson l’assomment un peu. Elle raconte: «On est arrivé ici après l’accident de Johnny, il a passé trois mois dans le coma. On avait tout, on a tout perdu. L’appartement, l’immeuble a été vendu. Il fallait se reloger, on n’avait pas de sous. On avait encore la voiture, on a dormi dedans. Puis sous tente, d’un endroit à l’autre. Bam-bam-bam-bam… dit-elle en mimant la chute. On avait tout.» Depuis le Covid, elle ne travaille plus, et puis on lui a volé son sac, elle n’a plus de carte d’identité. Pas d’amis non plus et plus guère de relations avec leur famille. «On est ensemble depuis dix ans, tient à préciser Johnny, un rien goguenard. Tout le temps ensemble à se chamailler…» Et à se soutenir. Il l’appelle «Princesse».
Kevin, leur voisin de parcelle, a emménagé il y a une grosse semaine. Il est sur un nuage, il en bafouille même: «Franchement, je comprends pas tout tellement je trouve ça providentiel. C’est trop beau! Je suis content, c’est splendide!» Il est reconnaissant de tout, et particulièrement de la distribution de repas dont il a bénéficié quand il campait dans les coteaux. «P…! Ils nous ont bien aidés, tous les soirs un repas! On n’avait pas trop de sous et pour moi, la bouffe, c’est important. J’avoue, je prends quelques produits, mais je ne vais pas ne pas manger…» Il gesticule en égrenant d’une voix forte un chapelet d’aventures dont il est le héros. «Kevin gère assez bien ses affaires malgré un tempérament volcanique», commente Stéphane Riga, qui tempère cependant ce qui pourrait trop rapidement s’apparenter à un succès: si le jeune homme a pu s’installer si rapidement ici dans ces prémices d’indépendance, c’est parce que l’essai n’avait pas marché avec l’occupant précédent. «Les effets immédiats de nos actions sont extrêmement positifs, mais il ne faut pas croire que tout est facile, poursuit Stéphane. Le taux d’échecs reste élevé, les personnes que nous aidons sont en très fort décrochage et depuis fort longtemps. Nous ne les abandonnons pas, mais certains ont besoin de passer par un accompagnement psychosocial solide.»
Sortir du bois, c’est une sorte d’engagement affectif, dont ses membres doivent aussi se protéger. Virginie et Christophe sont décédés cette année, et ils sont sans nouvelles d’Isman* et de François*. Ménager une distance, préserver sa vie privée. En cela, un cadre pourrait les aider. «On entre dans une intimité qui n’est pas la nôtre, et cependant ils nous y invitent… Mais jusqu’où aller? Jusqu’où est-ce qu’on s’ingère dans les trucs des autres? Qui sommes-nous? Des bénévoles? Des personnes de contact?», s’interroge Sophie Bodarwé. Tout cela à la fois, et on a envie d’ajouter: des amis.