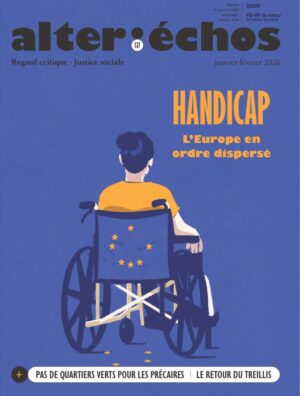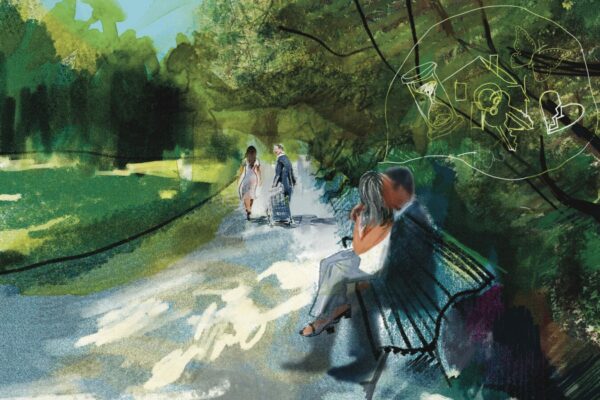Kevin Hartmann: Les réformes récentes répondent en partie aux défis démographiques et économiques, mais elles risquent d’accentuer certaines inégalités inhérentes au système, car elles n’ont pas été accompagnées de mécanismes redistributifs suffisants. On sait par exemple que les femmes, davantage confrontées au temps partiel ou aux carrières interrompues, perçoivent in fine des pensions moins généreuses. De même, beaucoup d’indépendants n’atteignent pas le seuil d’une carrière complète et voient leurs droits amputés. On a donc trouvé un équilibre financier relatif, mais son coût social est élevé.
Quentin Detienne: Le dernier rapport du Comité d’études sur le vieillissement, publié en juillet 2025, prévoit effectivement une diminution du poids des pensions dans le PIB belge d’ici à 2070. Mais cela se traduit par une accentuation des inégalités entre hommes et femmes (tant indépendants que salariés). Le débat public se concentre beaucoup sur la soutenabilité financière. Mais il faut tout autant interroger la soutenabilité sociale: est-il souhaitable d’accentuer les inégalités hommes-femmes, de baisser les montants de pension, déjà peu élevés?
KH: Selon moi, il s’agit d’une accentuation de la philosophie déjà présente dans les dernières réformes: un renforcement du principe de contributivité, une réduction de certaines dimensions de la solidarité, notamment intergénérationnelle et familiale, et davantage de responsabilité individuelle…
Le débat public se concentre beaucoup sur la soutenabilité financière. Mais il faut tout autant interroger la soutenabilité sociale: est-il souhaitable d’accentuer les inégalités hommes-femmes, de baisser les montants de pension, déjà peu élevés?
Quentin Detienne
QD: Si la tendance préexistait, l’intensité des mesures proposées aujourd’hui est inédite. Le gouvernement Arizona s’apprête à mettre en place des réformes d’une ampleur sans équivalent dans l’histoire du système de pension contemporain, soit depuis les années 50. Il y a donc, sinon une rupture, au moins une formidable accélération.
QD: Reculer l’âge légal à 66 ans aujourd’hui et 67 ans en 2030 a été la réforme la plus commentée. Mais le véritable basculement concerne selon moi l’accès à la pension anticipée. Il reste possible à 60 ans, mais la durée de carrière exigée est passée de 35 à 44 ans. Peu de travailleurs peuvent y prétendre. Pour la majorité d’entre eux, il faut donc désormais attendre 63 ans au moins. C’est une transformation profonde, passée relativement inaperçue.
KH: Le raisonnement officiel du recul de l’âge de la retraite en Europe est essentiellement démographique: avec le vieillissement de la population, le taux de dépendance – c’est-à-dire le rapport entre le nombre de retraités et d’actifs – augmente rapidement. La Commission européenne projette une dépense supplémentaire de 3,5% du PIB d’ici à 2070, d’où la nécessité d’allonger la durée de carrière. Mais on oublie un paramètre essentiel: la santé. L’espérance de vie en bonne santé, dans l’UE, stagne autour de 63 ans. Reculer l’âge légal à 67 ans signifie en réalité imposer de travailler potentiellement quatre ans en mauvaise santé. Ce choix, qui permet d’économiser un peu sur les pensions, risque de coûter bien plus cher à l’assurance-maladie ou au chômage.
KH: Exactement. La pénibilité interroge directement la notion de justice sociale : on ne peut pas demander la même chose à un enseignant universitaire et à un ouvrier du bâtiment.
Le raisonnement officiel du recul de l’âge de la retraite en Europe est essentiellement démographique: avec le vieillissement de la population, le taux de dépendance – c’est-à-dire le rapport entre le nombre de retraités et d’actifs – augmente rapidement. Mais on oublie un paramètre essentiel: la santé.
Kevin Hartmann
QD: Les chiffres sont édifiants. Chez les hommes, l’écart d’espérance de vie entre les plus éduqués et les moins qualifiés est de six ans. Pour l’espérance de vie en bonne santé, l’écart monte à dix ans et demi. Chez les femmes, les différences sont encore plus fortes: près de treize ans et demi entre les plus qualifiées et les moins qualifiées pour les années en bonne santé. Or les différentes réformes ignorent ces disparités.
QD: L’individualisation est double. Dans le système de pensions légales – ce qu’on appelle le premier pilier –, on a diminué le poids des «périodes assimilées», ces périodes de chômage, maladie ou maternité qui comptaient autrefois toutes comme du travail effectif dans le calcul. Cela a commencé dans les années 2010, sous le gouvernement Di Rupo. Et parallèlement, l’État pousse au développement du deuxième pilier, ce système de pensions complémentaires basé sur la capitalisation. Ici, seules les cotisations versées comptent; aucune solidarité ou presque n’est intégrée.
KH: Le gouvernement Arizona veut instaurer une cotisation obligatoire de 3% et l’étendre aux contractuels. Pour l’instant, ce deuxième pilier a vocation à compléter le premier, mais à long terme l’ambition du gouvernement est, je pense, d’en faire un substitut partiel. Or, l’expérience d’autres pays montre que la capitalisation engendre des risques financiers énormes et tend à renforcer les inégalités, puisque les ménages modestes y cotisent moins. Plusieurs pays d’Europe de l’Est ou d’Amérique latine qui l’avaient adopté sont revenus en arrière, faute de soutenabilité sociale.
QD: L’objectif affiché est de stabiliser le système en diversifiant les techniques – répartition d’un côté, capitalisation de l’autre. Mais le deuxième pilier aussi coûte cher à l’État, puisqu’il implique des diminutions de cotisations sociales et fiscales. Et pour les entreprises, ces 3% supplémentaires ne tombent pas du ciel : il faudra soit réduire les salaires nets, soit augmenter les salaires bruts. Derrière les arguments techniques, il y a bien entendu aussi une orientation idéologique.
QD: Le modèle des années 1950 reposait sur un schéma inégalitaire: l’homme gagne-pain, la femme au foyer. Le «taux ménage», qui accorde une pension majorée aux couples mariés où seule une personne a travaillé, symbolise cette logique. Elle est aujourd’hui encore discriminante envers les couples cohabitants ou non mariés. Cela reflète un modèle social daté. Surtout, comme la pension dépend des carrières passées, les femmes se retrouvent pénalisées. Carrières hachées, temps partiels, congés maternité, salaires plus faibles: tout cela produit mécaniquement des pensions moindres. Or les mécanismes correcteurs se réduisent. L’instauration d’un critère de 5.000 jours de travail effectif pour bénéficier de la pension minimum garantie exclut désormais une fraction importante de femmes, précisément celles à carrières incomplètes.
Le modèle des années 1950 reposait sur un schéma inégalitaire: l’homme gagne-pain, la femme au foyer. Le «taux ménage», qui accorde une pension majorée aux couples mariés où seule une personne a travaillé, symbolise cette logique. Elle est aujourd’hui encore discriminante envers les couples cohabitants ou non mariés. Cela reflète un modèle social daté.
Quentin Detienne
KH: Le phénomène est international. L’écart de pension homme-femme (gender pension gap) découle directement de l’écart salarial homme-femme (gender pay gap). La Belgique a des mécanismes redistributifs qui réduisent les écarts d’environ 25%, mais ils restent insuffisants. Tant que les discriminations salariales persisteront, elles se répercuteront automatiquement au moment de la retraite.
QD: Absolument. Historiquement, la retraite marquait une frontière nette: on cessait de travailler et on percevait une pension. Désormais, la pension s’apparente à un revenu garanti à partir d’un certain âge, que chaque individu peut compléter en continuant à travailler. Les flexi-jobs élargis aux retraités s’inscrivent dans cette logique. Ils bénéficient aux employeurs, qui paient des cotisations moindres, et aux pensionnés en bonne santé, capables d’augmenter leurs revenus. Mais ils creusent les inégalités entre ceux qui peuvent prolonger leur activité et ceux qui en sont empêchés pour des raisons de santé. Et, surtout, ils effacent de plus en plus la frontière entre vie active et retraite, encourageant une flexibilité accrue du travail.
KH: Les pensions des fonctionnaires locaux sont financées sur un système d’«enveloppe fermée»: seuls les agents encore en activité cotisent. Comme les communes recrutent de moins en moins de statutaires et de plus en plus de contractuels affiliés au régime salarié, les recettes s’effondrent tandis que les dépenses continuent d’augmenter. Le taux de cotisation de base aujourd’hui est d’environ de 45%, qui devrait augmenter à 70% ou plus pour garder l’équilibre. Pour la plupart des administrations locales, cela devient intenable et menace non seulement l’équilibre financier, mais aussi la continuité des missions de proximité envers les citoyens.
QD: À l’échelle fédérale, on observe un mouvement parallèle d’harmonisation entre fonctionnaires et salariés. La suppression de la bonification pour diplôme et l’introduction des pensions mixtes ont amorcé le rapprochement. Aujourd’hui, on va plus loin encore: aligner presque totalement les pensions publiques sur celles des salariés. C’est la fin d’une philosophie qui considérait la pension comme la continuation du dernier traitement, une reconnaissance institutionnelle du service public.
KH: La tendance dominante en Europe reste d’allonger les carrières et de retarder l’âge légal. Mais il existe des alternatives intéressantes. La Norvège et le Canada, par exemple, ont créé des fonds souverains qui capitalisent une partie des richesses nationales pour sécuriser le financement par répartition. La Belgique avait tenté un «Fonds de vieillissement», mais l’expérience a vite été abandonnée. Pourtant, une telle capitalisation collective, si elle est bien gérée, pourrait être un outil efficace pour renforcer l’équité et garantir une stabilité à long terme, sans accentuer les inégalités sociales.
La tendance dominante en Europe reste d’allonger les carrières et de retarder l’âge légal. Mais il existe des alternatives intéressantes. La Norvège et le Canada, par exemple, ont créé des fonds souverains qui capitalisent une partie des richesses nationales pour sécuriser le financement par répartition. La Belgique avait tenté un «Fonds de vieillissement», mais l’expérience a vite été abandonnée.
Kevin Hartmann
QD: Penser les pensions, ce n’est pas seulement parler de chiffres. C’est penser la manière dont une société répartit ses richesses et reconnaît le travail. Encore faut-il aussi redéfinir ce qu’on entend par «travailler». Limiter cette notion à l’activité rémunérée efface notamment des pans entiers du travail domestique, assuré majoritairement par des femmes. Derrière les pensions, se cachent donc toujours des débats plus vastes sur la distribution des richesses produites, les inégalités sociales de santé et la place du travail, y compris le travail non rémunéré.
KH: Le socle fondateur – solidarité intergénérationnelle, redistribution par cotisations, existence d’une pension minimum – reste présent. Mais son poids s’affaiblit face à une logique contributive de plus en plus forte. Si la Belgique franchissait le pas vers un système essentiellement capitalisé, ce serait une rupture radicale qui signerait la mort du principe de solidarité.
QD: La disparition annoncée du régime des statutaires marque à mon sens un basculement. C’est la fin d’un modèle vieux de deux siècles. La pension y apparaissait comme un droit personnel à la rémunération, loin de la logique marchande du travail salarié. Cette disparition appauvrit les façons de penser la rémunération du travail, et donc son organisation. Est-ce au marché de dire ce qu’est la justice sociale ou cette question doit-elle être tranchée par d’autres institutions? Vaste thème, présent aussi au cœur des réformes des pensions.