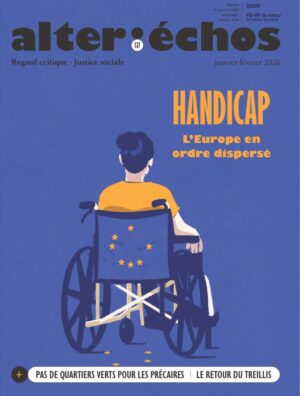La Commission européenne a mis ses propositions sur la table en juillet dernier, dévoilant un budget fixé à près de 2.000 milliards d’euros, soit 1,26% du revenu national brut de l’Union européenne. En comparaison, le précédent cadre financier pluriannuel (2021-2027) atteignait 1.270 milliards d’euros. Le montant, par son ampleur, est donc inédit. L’institution, installée au cœur du quartier européen de Bruxelles, a aussi innové en repensant l’architecture globale du budget, en travaillant cette fois en trois piliers – l’agriculture et la cohésion (pour 45% du budget), la compétitivité (30%) et «l’Europe globale» (10%). Le reste du budget doit servir à l’administration, pour «faire tourner» les institutions.
La Commission européenne a également introduit (et c’est nouveau) des «plans de partenariats nationaux et régionaux», selon la formule consacrée. Ces plans «visent à regrouper et de fusionner des fonds européens, comme ceux de la PAC et de la politique de cohésion, sous des enveloppes nationales et régionales», explique l’institution. En clair, pour les 45% du budget susmentionnés, un pot commun serait mis en place, et divisé en 27, pour les 27 États membres de l’UE. Mais pas à parts égales: les calculs seront effectués en fonction des «niveaux relatifs de développement économique» des États, «de leur population et de la population vivant dans des zones rurales exposée au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale».
L’institution, installée au cœur du quartier européen de Bruxelles, a aussi innové en repensant l’architecture globale du budget, en travaillant cette fois en trois piliers – l’agriculture et la cohésion (pour 45% du budget), la compétitivité (30%) et «l’Europe globale» (10%). Le reste du budget doit servir à l’administration, pour «faire tourner» les institutions.
Le Copa-Cogeca, qui porte la voix des agriculteurs européens à Bruxelles, a immédiatement dénoncé une «dissolution de la PAC» et a organisé, durant l’été, une grande «marche vers le Berlaymont», le quartier général de la Commission, pour faire entendre à l’institution tout le mal qu’il pensait de cette proposition. La Commission, elle, se défend: «Les agriculteurs de l’UE continueront de recevoir l’aide dont ils ont besoin au moyen d’une aide au revenu spécifique de la PAC, y compris des paiements fondés sur la superficie, une aide couplée au revenu, des investissements, un soutien aux petits et jeunes agriculteurs et des incitations en faveur de mesures agro-environnementales», promet l’institution. L’eurodéputé français socialiste Christophe Clergeau n’est pas convaincu. Au contraire, il dénonce «le massacre de la politique de cohésion et de la politique agricole, qui fait, ensemble, la politique rurale de l’UE». À ses yeux, cette dernière est «totalement sacrifiée».
Où est «le social»?
Le deuxième grand pilier du budget à long terme de l’UE, celui consacré à la compétitivité, ne fait pas non plus que des heureux. Certes, l’Europe est d’avis qu’il faut urgemment permettre au continent de regagner en compétitivité face au reste du monde, notamment face à la Chine et aux États-Unis et en proposant un nouveau Fonds pour la compétitivité, la Commission entend tenter de renverser la vapeur et de mieux financer, dans l’UE, la décarbonation de l’industrie, la transition numérique ou encore les industries de défense présentes sur le territoire. Ce fonds est d’ores et déjà surnommé «fonds Draghi», en référence à l’ancien président du Conseil italien et ex-président de la Banque centrale européenne (BCE), qui, en septembre 2024, avait publié un rapport sur l’avenir de la compétitivité en Europe. Ce travail est, au fil des mois, devenu l’alpha et l’oméga de l’action de la Commission.
Mais la députée européenne belge Estelle Ceulemans regrette que la Commission ait fait de la compétitivité son «nouveau mantra», et elle est loin d’être la seule. «Dans une période qui voit un accroissement des inégalités sociales, la part du budget alloué à la cohésion économique, sociale et territoriale est fortement diminuée par rapport à la période de programmation 2021-2027», estime cette membre de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) au Parlement européen. Son groupe politique a calculé que de 65% dans le cadre financier pluriannuel (CFP) actuel, cette part passe à 45% dans le prochain CFP.
Estelle Ceulemans souligne notamment que «le Fonds social européen (FSE+), qui représentait un budget de 142,7 milliards d’euros, est mentionné, mais n’est, à l’heure qu’il est, pas doté d’une ligne budgétaire propre. Ce qui signifie, avec cette proposition, que le Fonds social européen n’existe plus véritablement et qu’il n’y a plus d’obligation d’investir dans les politiques sociales et d’emploi». Elle pointe aussi du doigt la «disparition» du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Cet outil permettait d’indemniser des travailleurs licenciés en cas de restructuration d’entreprises.
«Avec ce seul prisme de la compétitivité, Ursula von der Leyen ne voit l’Union européenne que comme un grand marché, au seul bénéfice des entreprises, et creuse encore plus le fossé entre elle et des citoyens européens confrontés à la hausse du coût de la vie, à une flexibilisation à outrance du marché du travail qui augmente les risques de burn-out, à un sentiment d’abandon et de déclassement qui fait le lit des idées nauséabondes de l’extrême droite», abonde Estelle Ceulemans.
Estelle Ceulemans souligne notamment que «le Fonds social européen (FSE+), qui représentait un budget de 142,7 milliards d’euros, est mentionné, mais n’est, à l’heure qu’il est, pas doté d’une ligne budgétaire propre. Ce qui signifie, avec cette proposition, que le Fonds social européen n’existe plus véritablement et qu’il n’y a plus d’obligation d’investir dans les politiques sociales et d’emploi».
Dans son discours sur l’état de l’Union prononcé à Strasbourg devant les eurodéputés le mercredi 10 septembre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a tenté de se justifier. Selon elle en effet, «lorsque nous parlons de compétitivité, nous parlons d’emplois, nous parlons de personnes et de leurs moyens de subsistance». Et il est donc essentiel d’après elle «de doter les travailleurs de moyens d’action renforcés si nous voulons disposer d’une économie compétitive», et ce par le biais d’un nouveau futur «règlement pour des emplois de qualité». Ses contours n’ont pas encore été esquissés.
La Belgique, ce pays «frugal»
Pour ce qui est du financement de ce budget post-2027, la Commission européenne envisage l’introduction de nouvelles ressources propres pour l’UE (qui rimerait notamment avec un nouveau système de taxation des grandes entreprises présentes sur le Vieux Continent). Ces ressources propres devraient, selon les plans de la Commission, compter pour 58 milliards d’euros par an. Mais là encore, tous ceux qui ont leur mot à dire sur ce projet n’ont pas le même avis, loin de là.
Concrètement, Parlement européen et Conseil de l’UE (qui rassemble les États membres) négocient chacun de leur côté les propositions de la Commission. Ensuite, ils tentent d’accorder leurs violons. Un accord provisoire est espéré pour la fin de l’année. Puis, en plus de l’approbation par le Parlement européen, une adoption à l’unanimité est nécessaire au Conseil, ce qui signifie qu’une seule capitale peut bloquer le processus.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a ainsi d’ores et déjà déclaré qu’il bloquerait l’adoption du cadre financier pluriannuel si la Commission ne débloquait pas certains fonds actuellement gelés en faveur de Budapest. De manière plus générale, les pays dits «frugaux» (dont la Belgique, mais aussi les Pays-Bas, l’Allemagne, la Finlande ou la Suède) restent traditionnellement opposés à toute augmentation de leur contribution au budget de l’UE.
En Belgique, justement, la coalition Arizona actuellement au pouvoir est, elle aussi, plongée dans les chiffres. Dans le pays, les pourparlers ne se jouent pas à sept ans, et c’est actuellement le budget 2026 qui est négocié, dans des termes parfois relativement similaires à ce qui se joue à l’échelon européen. En effet, la Belgique comme l’UE entendent financer davantage le secteur de la défense. Dans le budget de l’UE, c’est l’un des domaines qui sort «gagnant» de la proposition de la Commission – à la différence du social, par exemple. En Belgique, le gouvernement s’est engagé à porter à 5% du PIB ses dépenses de défense.
En Belgique, justement, la coalition Arizona actuellement au pouvoir est, elle aussi, plongée dans les chiffres. Dans le pays, les pourparlers ne se jouent pas à sept ans, et c’est actuellement le budget 2026 qui est négocié, dans des termes parfois relativement similaires à ce qui se joue à l’échelon européen. En effet, la Belgique comme l’UE entendent financer davantage le secteur de la défense.
Mais l’économiste Giuseppe Pagano, professeur émérite à l’Université de Mons, rappelle que la Belgique n’a jamais été une «bonne élève» en matière budgétaire. Comprendre: les déficits filent. «Dans le budget 2024, les dépenses militaires de la Belgique représentent 1,3% du PIB. S’engager sur 5%, c’est forcément accepter de comprimer d’autres dépenses. En économie, on appelle cela l’effet du coucou, en référence au coucou qui pond son œuf dans un autre nid avant que l’oisillon n’expulse les autres œufs pour faire sien ce nid. Or au niveau de l’UE comme de la Belgique, la question est toujours la même: quelles autres dépenses comprimer?» Là encore, le social (le remboursement des soins de santé en tête, mais pas seulement) pourrait faire les frais de la direction prise par la coalition Arizona menée par le Premier ministre nationaliste flamand Bart de Wever.
L’eurodéputée écologiste belge Saskia Bricmont regrette, à l’échelon de son pays comme de l’UE, cette «tendance massive à investir dans la défense au détriment des autres secteurs». À ses yeux, «ni au niveau européen ni au niveau belge, la direction prise est celle de davantage d’investissement dans le social». Elle rappelle que l’UE s’était notamment engagée à avancer vers plus d’égalité dans le secteur du logement. Or à part de grandes annonces à l’occasion du discours sur l’état de l’Union, «pour l’instant, on n’en a pas vu la couleur», lance l’élue wallonne, qui reproche à la Commission européenne d’appliquer, à l’heure actuelle, «un agenda conservateur». Le temps pas si lointain où l’exécutif européen ne jurait que par le «Pacte vert» et la décarbonation du Vieux Continent semble définitivement révolu. Et le budget 2028-2035 est l’un des principaux témoins des mécanismes à l’œuvre.