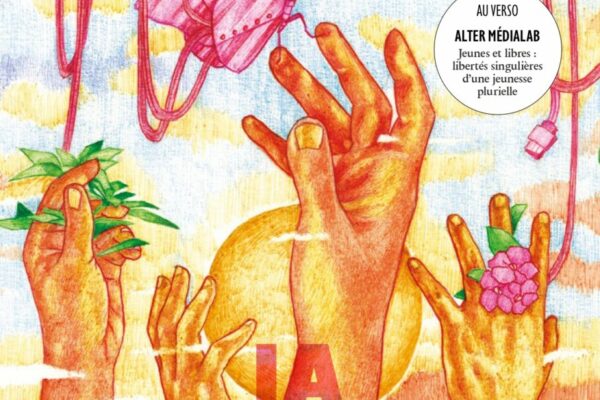Le travail social est-il particulièrement pénible ? Et quelles sont les raisons de cette pénibilité éventuelle ? Plongée dans la psyché, parfois un peu torturée, d’un secteur sur lequel plusieurs intervenants extérieurs jettent un regard interpellant.
Les travailleurs sociaux sont-ils proches du burnout ? Poser cette question revient à en soulever bon nombre d’autres tant le sujet semble vaste. On peut ainsi se demander en premier lieu ce qu’on entend en général par « travailleurs sociaux ». S’agit-il par exemple des travailleurs du secteur non-marchand où parle-t-on ici des individus évoluant dans le domaine du social stricto sensu ? Deuxième interrogation légitime : existe-il une pénibilité « sectorielle » spécifique au travail en milieu social ? « En parlant de métiers du social, on peut dire que l’on parle de métiers de services, relationnels, où un travail avec autrui est effectué par un intervenant qui est, en quelque sorte, son premier outil », explique Abraham Franssen, sociologue aux facultés universitaires Saint-Louis[x]1[/x] et auteur notamment d’un travail intitulé « Les travailleurs sociaux : héros et victimes ». Educateurs, agents d’insertions, assistants sociaux et autres font ainsi partie de ce vaste groupe de personnes qui, pour les définir un peu différemment « sont mandatées pour intervenir vis-à-vis de personnes définies comme ayant besoin d’une aide ». Des précisions intéressantes, mais qui ne tranchent pas vraiment la question.
Face à sa tâche, peut-on dire que ce type de travailleur, qu’il soit du non-marchand ou du « social » stricto sensu, peut être soumis à une pénibilité du travail plus importante que celle ressentie dans d’autres secteurs ? D’un point de vue « clinique », la réponse semble être « non » si l’on en croit la Clinique du stress du centre hospitalier Brugmann[x]2[/x] qui a mis sur pied, il y a quelques temps, une recherche concernant le non-marchand. Résultat des courses : les 2 000 personnes testées n’ont pas permis de mettre en avant de conclusions probantes. Au point que les résultats de la recherche n’ont pas été publiés. « Bien sûr, nous recevons des travailleurs du secteur non-marchand, mais nous les recevons au même titre que des travailleurs d’autres secteurs », déclare-t-on à la Clinique du stress ou l’on précise tout de même que le type de pressions subies, et qui peut mener à du stress voire à un burnout, est de nature variée selon les secteurs.
Des origines sectorielles
Si les travailleurs sociaux ne semblent donc pas souffrir au travail plus que d’autres, les mécanismes qui les font souffrir, eux, leur seraient bien particuliers. « Une caractéristique forte du travailleur social est qu’il vit souvent un clivage entre l’idéal qu’il se fait de son métier et sa réalité plus prosaïque en termes de ressentis », explique Abraham Franssen. Si l’on parle d’idéal, c’est que l’image que le travailleur social se fait de sa fonction serait liée à « une envie de sauver », d’après Anne-Françoise Gailly, formatrice, coach et thérapeute à Heo[x]3[/x]. « Il s’agit d’un secteur que les gens choisissent parce qu’ils veulent défendre une cause, continue-t-elle. Cela implique une grande implication au niveau des valeurs, liées au service, à l’utilité, au sens. »
Et lorsque cet idéal vient se frotter à la réalité, la frustration n’est jamais loin. « Tout ce qui apparaît dès lors comme limitant cet idéal relationnel d’aide, d’accompagnement désintéressé tend à être défini comme source de frustration », enchaîne Abraham Franssen. Une frustration qui peut également mener à un sentiment de manque de reconnaissance, une doléance que l’on entend régulièrement dans le secteur. Néanmoins, Anne-Françoise Gailly précise que ce sentiment de manque de reconnaissance existe partout. « Quand une personne entre en insatisfaction, elle a tendance à se plaindre de problèmes de reconnaissance. Mais c’est la source de la reconnaissance, ou de la non reconnaissance, qui est différente, explique notre interlocutrice. Dans le privé, la reconnaissance peut venir de l’argent, d’une voiture de fonction. Dans le social, ces éléments ne sont pas le moteur du fonctionnement des travailleurs qui, je l’ai dit, veulent « sauver le monde » et sont très idéalistes. Or, quand ils commencent à travailler, c’est « Bienvenue dans le monde réel ». Les travailleurs se rendent compte qu’ils sont à 17 pour faire le travail de 50 personnes, que les conditions de travail sont éprouvantes, ce qui engendre du stress… »
Des conditions de travail qui deviendraient d’ailleurs plus compliquées suite à certaines évolutions récentes de la société, si l’on en croit les échos provenant régulièrement du terrain. Souvent mis en cause, l’Etat social actif, avec ses impératifs d’activation, mettrait ainsi de plus en plus souvent les travailleurs sociaux en porte-à-faux vis-à-vis de leur mission d’aide. Ainsi en irait-il également de la plus grande emprise de la logique marchande sur le secteur. Face à cette hypothèse, Abraham Franssen nuance. « Je pourrais vous citer des textes de 1973 où l’on retrouve à peu près les mêmes propos, explique-t-il. Ce type de revendication est inhérent à la double loyauté de ces travailleurs, coincés entre des pouvoirs qui ont des fonctions normatives et leur public. Ils sont en quelque sorte des intermédiaires entre la violence du pouvoir et la misère du monde. »
Des tabous et des « antivaleurs »
Anne-Françoise Gailly note également que le secteur, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de l’associatif, est traversé de « tabous » qui viennent souvent mettre les travailleurs en difficulté. « Il y a tout d’abord le tabou de l’argent qui revient à dire : « On fait ce travail par conviction, on est content d’être payé, on ne va pas demander trop » », explique-t-elle. Vient ensuite le tabou lié aux heures de travail « qu’on ne compte bien sûr pas, il ne faut pas exagérer ». Et enfin une série de tabous liés au pouvoir, aux définitions de fonction ou encore à l’évaluation du travail.
Ces tabous généreraient une série d’« antivaleurs » (« l’argent c’est mal », « compter ses heures c’est mal ») induisant des excès caractérisés par un travail trop prenant, mal payé, mal piloté. Ce qui, couplé avec l’engagement personnel des travailleurs du social, donne une petite bombe à retardement si l’on sait que le burnout résulterait d’un déséquilibre « entre ce que je donne et ce que je reçois », d’après Anne-Françoise Gailly.
Tout serait-il donc dans la tête ? Que nenni. Ces tabous ont aussi des conséquences concrètes sur l’organisation de certaines structures. Travailleurs naviguant à vue pour cause d’absence de définition de fonction ou d’évaluation du travail, organigramme faible ayant comme conséquence « que lorsque la situation dégénère pour une raison ou une autre, la structure se retrouve à la merci de la mésentente ou de l’entente entre les personnes. Tout est alors très personnalisé, on se retrouve dans le domaine de l’affectif », la liste est longue. Et la gestion des ressources humaines en prendrait, elle aussi, un petit coup. « Comme l’objet de la structure est noble, on ne réfléchit bien souvent pas à la manière dont on poursuit cet objet, explique Anne-Françoise Gailly. J’ai déjà pu constater dans certaines associations des pratiques en matière de ressources humaines qu’une PME syndiquée n’aurait jamais acceptée. Et, bien souvent, les directions n’en sont pas conscientes, pas plus que l’ensemble des travailleurs de la structure ne se rend compte qu’il est aussi partie du problème, qu’ils participent en fait tous à un système qui n’est pas écologique d’un point de vue humain. »
Dès lors, les syndicats ne pourraient-ils avoir une influence « correctrice » sur certains des phénomènes évoqués ? A la CNE[x]4[/x], on a un avis sur la question et sur le rôle des syndicats dans le secteur. « Lorsqu’on se trouve dans une logique hiérarchique courte, comme c’est souvent le cas dans l’associatif, il est compliqué d’avoir une représentation syndicale. Certains travailleurs sont dans un esprit un peu « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » et voient donc les syndicats comme quelque chose d’utile pour l’extérieur, mais pas au sein de leur structure, même s’ils sont parfois affiliés à titre personnel. Organiser le personnel de manière collective est donc compliqué », explique Patricia Piette, secrétaire permanente nationale CNE, qui note également que les travailleurs ont dès lors tendance à faire appel aux syndicats lorsque la situation est devenue très compliquée à gérer. Autre problème : la taille des structures. « Dans une équipe de cinq travailleurs, envoyer un élément se former au syndicalisme peut être parfois handicapant », note-elle avant de préciser que bon nombre de structures n’ont pas le nombre de travailleurs minimum pour accueillir une délégation syndicale, comme c’est le cas dans la CP 329 (socioculturel) où le seuil minimum de 15 travailleurs en vigueur est rarement atteint.
Le travailleur garde la main ?
Outre ces facteurs internes au secteur, des facteurs plus conjoncturels ont également une influence. Société de plus en plus changeante, accélération des technologies, standardisation du travail mettant à mal l’autonomie des travailleurs, travail administratif de plus en plus lourd, pénibilité due à l’exposition aux « malheur des gens » sont ainsi cités. Et puis les caractéristiques traditionnelles de ce genre de postes, faits souvent de mi-temps à horaires variables rendant difficile leur combinaison avec un autre mi-temps, jouent aussi un rôle, de même qu’une certaine « désinstitutionnalisation ». « Nous sommes passés d’un modèle institutionnel à quelque chose de plus co-construit, un traitement plus égal avec le public. Or, l’institution, c’est ce qui fait frontière. La désinstitutionnalisation a engendré le fait que le travailleur ne peut plus se réfugier derrière sa fonction et se trouve donc plus exposé », explique Abraham Franssen.
Un travailleur qui, finalement, garde la clef de sa situation, notamment en termes de ressenti. « Il y a la réalité objective, et puis la manière dont on vit les faits, explique Abraham Franssen. Tout cela est vécu de manière différente par rapport au modèle de référence du professionnel. »
1. Facultés universitaires Saint-Louis :
– adresse : 43, bd du jardin botanique à 1000 Bruxelles
– tél.: 02 211 78 11
– courriel : info@fusl.ac.be
– site : http://www.fusl.ac.be
2. Centre hospitalier Brugmann (siège social) :
– adresse : place Van Gehuchten 4 à 1020 Bruxelles
– tél.: 02 477 21 11
– site : http://www.chu.brugmann.be
3. Heo :
– adresse : 368A bd Lambermont à 1030 Schaerbeek
– tél.: 0498 944 760
– courriel : info@heo-ressources.be
– site : www.heo-ressources.be
4. CNE, secrétariat général :
– adresse : av Robert Shuman 52 à 1400 Nivelles
– tél.: 067 88 91 91
– courriel : cne.sg@acv-csc.be
– site : http://www.cne-gnc.be