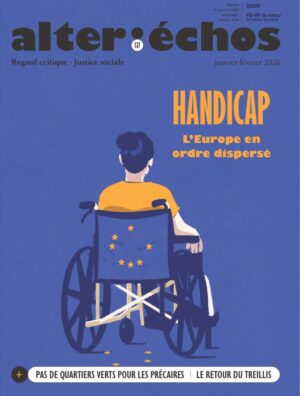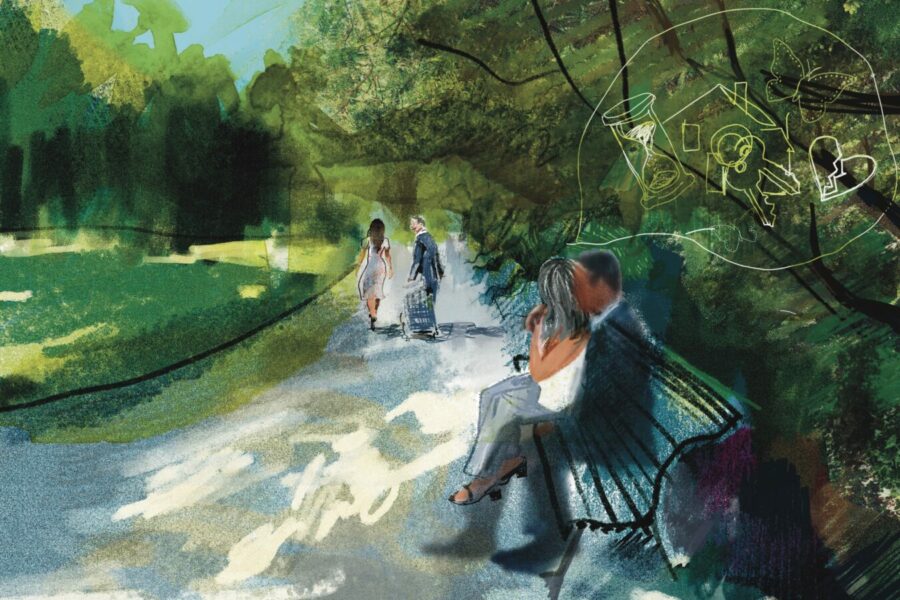Giorgia vit depuis peu dans la résidence secondaire non loin de la maison familiale, acquise avec son désormais ex-mari. Il y a quelques mois, elle a décidé de le quitter, après plus de 40 ans de mariage, trois grands enfants et deux petits-enfants. Parce qu’à 70 ans, la vie n’est pas finie. Aujourd’hui, Giorgia ne s’ennuie pas, entre la chorale, la poésie, son engagement associatif et ses chats. Elle a maintenant une chambre et un agenda «à soi», et un portefeuille à elle toute seule.
Un phénomène en hausse
Des Giorgia – ou des Georges –, il y en a de plus en plus, comme en attestent les chiffres de Statbel de 2023 sur les divorces. En dix ans, les séparations de couples dont les deux partenaires ont plus de 65 ans ont considérablement augmenté: de 443 en 2013 à 675 en 2023 (de 1,78% à 3,37% des quelque 20.000 divorces comptabilisés en 2023). Le chiffre est modeste, mais fait significatif: le taux de divorces est en augmentation à partir de 50 ans alors qu’il diminue dans toutes les autres tranches d’âge.
Le phénomène a pris le nom de «divorce gris», référence à la couleur des cheveux. «Le terme est employé pour la première fois dans un article scientifique américain de 2012 pour qualifier le doublement des séparations des plus de 50 ans entre 1990 et 2010», retrace Léa Cimelli, économiste et chercheuse post-doctorale à l’Institut national d’études démographiques sur les questions d’inégalités femmes-hommes.
Le taux de divorces est en augmentation à partir de 50 ans alors qu’il diminue dans toutes les autres tranches d’âge.
«Il s’est répandu en Europe et en Belgique. Les générations issues du baby-boom, arrivées à la retraite, sont les premières à illustrer cette évolution. Elles rompent avec les schémas conjugaux traditionnels, plus linéaires», constate Énéo, mouvement social des aînés, dans une récente analyse à ce sujet. Elle avance plusieurs explications. La première, c’est bien connu: si le cœur a ses raisons, la raison n’ignore plus, avec le temps, la lassitude de la vie à deux, les infidélités, les difficultés – voire violences – accumulées. Ensuite, le divorce n’est plus source d’opprobre social comme il y a quelques dizaines d’années. Autres raisons: l’allongement de l’espérance de vie (82,4 ans en 2024) a pour conséquence d’augmenter statistiquement la possibilité d’une séparation et l’opportunité d’épanouissement personnel; la période de transition de la retraite qui peut renforcer l’impact du départ des enfants (le fameux «nid vide»), mais aussi les problèmes de santé pouvant modifier les équilibres de couple. Enfin, la plus grande indépendance financière des femmes.
Le coût du divorce
Si Giorgia a pu partir, c’est parce qu’elle en avait l’envie mais aussi les moyens. Mais combien de Giorgia pour combien de Gwendoline, ce personnage fictif mais très réaliste de l’essai de Titiou Lecoq, «Le couple et l’argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes», qu’on suit à toutes les étapes de sa vie? Gwendoline se sépare aussi. Et elle le paie.
«L’autonomie financière, c’est le droit de vivre comme on le désire. ‘J’ai un conjoint encombrant, j’ai un conjoint violent, je me permets de le quitter parce que j’ai les moyens’», défendait au magazine axelle Myriam Delmée, présidente du Setca. Un désir, une nécessité – parfois vitale – que des femmes ne peuvent pas se permettre. Ou, si elles sautent le pas – d’après des chiffres français, elles seraient pour trois quarts à l’initiative –, elles en paient le prix.
D’abord en raison du coût du divorce: entre 930 €, quand les ex-conjoints se mettent d’accord, et plus de 4.000 € dans les situations plus conflictuelles, d’après une étude récente de la Ligue des familles.
Ensuite parce que quitter son conjoint engendre une perte de niveau de vie: 22% pour les femmes, contre 3% pour les hommes, selon les calculs de l’association française La Fondation des femmes. Léa Cimelli a spécifiquement étudié les conséquences économiques genrées des dissolutions d’union après 50 ans en France dans les années 2010. Pour cette tranche d’âge, «la baisse de niveau de vie pour les hommes est de 6% un an après le divorce et de 24% pour les femmes», relève-t-elle. Avec des différences selon les tranches de revenus. «De l’ordre de 34% pour les femmes qui appartiennent aux 25% des tranches les plus aisées contre 10% pour celles qui appartiennent aux 25% des moins aisées», précise l’économiste, avançant l’hypothèse que les revenus varient moins entre les hommes et les femmes dans les tranches les plus basses. «Le risque de pauvreté par contre est beaucoup plus grand pour les femmes dans ces tranches-là.»
Les femmes perdantes du couple
«La variation du niveau de vie au moment du divorce est corrélée aux inégalités de revenus internes au couple, et ce sont majoritairement les femmes qui gagnent le moins», poursuit l’économiste, mettant là en lumière un constat largement établi: le divorce est révélateur des inégalités dans le couple. Quelques chiffres suffisent à illustrer la situation.
La présence des femmes sur le marché du travail d’abord: près de 63% en 2022 contre 70% d’hommes. La différence est sensible, mais elle croît à mesure que le nombre d’enfants dans le ménage augmente: 10,2% dans les situations avec deux enfants, et jusqu’à 25% à partir du troisième. Autre explication: le travail à temps partiel. Celui-ci a triplé au cours de ces quarante dernières années, tous genres confondus. Mais les femmes y restent majoritaires: entre 22,7% et 31,2%, contre maximum 8,9% chez les hommes. Un dernier chiffre pour la route? 21%, l’écart de pension total (légale et complémentaire): 1.825 euros brut pour les femmes, 2.324 euros pour les hommes.
«La variation du niveau de vie au moment du divorce est corrélée aux inégalités de revenus internes au couple, et ce sont majoritairement les femmes qui gagnent le moins.»
Léa Cimelli, économiste et chercheuse post-doctorale à l’Institut national d’études démographiques sur les questions d’inégalités femmes-hommes.
Il y a aussi ce qui se comptabilise moins, ou plus difficilement: l’inégale répartition de la charge parentale – et du care de façon générale – qui compte pourtant beaucoup dans la production des inégalités dans le couple. Enfin, les inégalités se marquent aussi dans les dépenses. «Dans les couples hétérosexuels mariés, c’est souvent Monsieur qui gère les affaires financières, Madame les dépenses du quotidien, et elle n’est parfois pas du tout mise au courant des affaires financières», fait observer Soizic Dubot, spécialiste des questions socio-économiques chez Vie féminine. Avec des conséquences à long terme: une étude de l’économiste Arthur Apostel (UGent), publiée par la Banque nationale en mai dernier sur l’évolution des inégalités de richesse, révèle «qu’en moyenne, les hommes possèdent un patrimoine net plus important que les femmes, en particulier dans les tranches d’âge les plus élevées».
Titiou Lecoq résume la situation par la théorie du pot de yaourt. Les femmes remplissent le frigo, les hommes achètent le matériel ou placent leur argent. Dans ce système à deux vitesses, les femmes se retrouvent, à leur séparation, avec des pots de yaourt vides. La séparation met un spot sur les pactes tacites, arrangements et sacrifices imposés ou choisis durant l’union, les «50/50» de façade et les régimes matrimoniaux inégalitaires qui, tout au long de la vie de couple, pénalisent les femmes, souvent à leur insu.
Comment compenser?
«Plus tu divorces âgée, moins tu as des possibilités de compenser», constate Soizic Dubot. «Au niveau du logement par exemple, illustre-t-elle. La question de l’habitat des femmes âgées est déjà globalement compliquée. Mais pour les femmes plus âgées seules, ça l’est encore plus: accès au crédit difficile, difficultés liées au fait d’être locataire (notamment la hausse des loyers ou les discriminations des propriétaires) et manque crucial de logements sociaux.»
Les femmes peuvent compenser par le travail – en passant d’un temps partiel à un temps plein ou en retournant sur le marché du travail –, mais, là aussi, l’âge ne joue pas en leur faveur.
Que leur reste-t-il alors? Leur seule possibilité est-elle de se remarier pour retrouver, a minima, les économies d’échelle permises par le couple?
D’abord, il faut qu’elles le désirent – ce qui, observent nos diverses interlocutrices, est moins fréquent que chez les hommes, les femmes pouvant être «lassées de prendre soin» – et, de toute façon, elles sont aussi discriminées sur ce terrain-là. «Les femmes vivent plus longtemps que les hommes», relève Léa Cimelli. «Elles ont moins la possibilité de se remettre en couple, puisqu’elles perdent de la valeur sur le “marché de la bonne meuf” pour citer Virginie Despentes», ajoute Soizic Dubot.
Qui doit payer?
Les femmes peuvent aussi demander que l’ex-conjoint leur paye une pension alimentaire afin que soient reconnus leurs contributions et sacrifices invisibles et qu’elles puissent avoir un niveau de vie proche de celui d’avant la séparation. Ce dispositif – malgré ses ambitions égalitaires – comporte plusieurs obstacles, identifiés par une étude de 2024 sur la transmission genrée du capital familial (commandée par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes): le renoncement des femmes par «fierté, évitement d’une dépendance financière, facilitation de l’obtention de contributions alimentaires pour les enfants»; la longueur et l’incertitude de la procédure; les difficultés de prouver «l’état de besoin et la dégradation significative de la situation économique» – requises pour l’obtention de la pension, mais aussi les biais de genre des professionnels de la justice, défavorables aux femmes. Résultat, si l’on se réfère aux données françaises: cette pension est moins opérante que la pension alimentaire pour les enfants, déjà elle-même défaillante.
Les femmes peuvent aussi demander que l’ex-conjoint leur paye une pension alimentaire afin que soient reconnus leurs contributions et sacrifices invisibles et qu’elles puissent avoir un niveau de vie proche de celui d’avant la séparation. Ce dispositif – malgré ses ambitions égalitaires – comporte plusieurs obstacles.
Il existe encore la pension de divorcé, complément versé par la Sécurité sociale et non par l’ex-conjoint, sorte de prime pour compenser les années de travail non prestées. «Cette dernière peut être une protection et une reconnaissance sociale pour certaines femmes, mais elle génère aussi des inégalités, entre couples, entre femmes et entre catégories sociales, relève Soizic Dubot. Nous plaidons pour un système permettant la constitution de droits personnels suffisants garantissant aux femmes et à tous une pension digne et une autonomie économique tout au long de la vie. Aujourd’hui, le gouvernement fait tout le contraire: il veut supprimer la pension de divorcé sans donner aucun moyen à la constitution de droits personnels.»
Léa Cimelli, à l’issue de ses recherches, souligne la nécessité d’un modèle hybride. «Il faut continuer à promouvoir l’égalité de genre tout au long du parcours professionnel à travers des choix d’éducation, de métiers, des revendications salariales mais aussi la promotion de la répartition du travail domestique. Cela va aider à augmenter les capacités de récupération individuelle une fois le divorce survenu. Mais une intervention de l’État est aussi nécessaire, précise-t-elle, pour ne pas laisser les individus dans des écueils qui les empêchent de se protéger et creusent les inégalités de genre dans la société»; une nécessaire articulation de l’individuel et du collectif pour que Giorgia et Gwendoline puissent tout recommencer, sur un pied d’égalité.