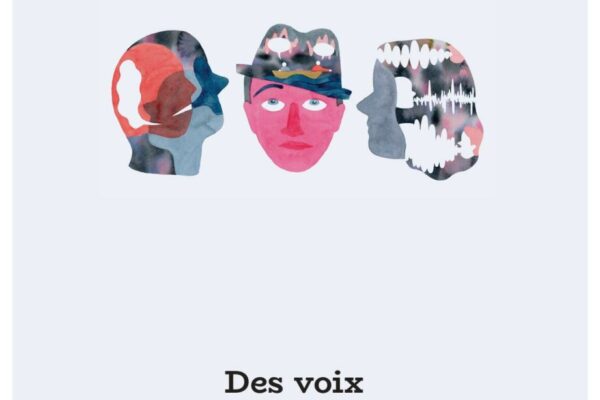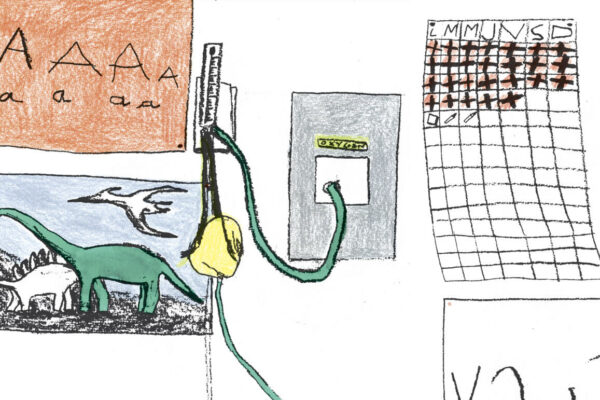Vendredi, 12 h 45. La réunion du groupe «la voix des usagers» du club psychosocial «La Charabiole» va bientôt commencer. À l’entrée de cet ancien cinéma de Saint-Servais, Stéphane Waha, pair-aidant, accueille les participants par un sourire, quelques mots. Les poignées de main ou la tape sur l’épaule, ce sera pour plus tard, et, en cette période de Covid, on ne peut pas trop prendre le temps de bavarder ensemble dans le couloir. Il faut rejoindre la grande salle où attendent déjà le coordinateur de la Charabiole, Eric Faveaux, et le psychologue Denis Collet. Tous les participants sont des résidents de l’IHP (Initiative d’habitations protégées) L’Espoir, une structure d’aide au retour à l’autonomie pour les personnes qui vivent la maladie mentale, créée par l’hôpital psychiatrique Le Beau Vallon à Namur. Stéphane est pair-aidant. Il fait partie de l’équipe de «La Charabiole» mais avec une expérience et un savoir particuliers, puisqu’il a vécu, comme certains résidents, des troubles bipolaires.
Comme chaque vendredi, on discute dans ce groupe de toutes les petites et grandes questions de la vie quotidienne des résidents des habitations protégées: la vaccination comme le retrait du Coca Light du distributeur de boissons et son remplacement par de l’eau gazeuse. Ce jour-là, le groupe parle aussi de lui-même et plus précisément de sa participation en tant que conseil des usagers au «Reintegration Award» organisé par le CRéSaM (Centre de référence en santé mentale) qui récompense les initiatives de réintégration des personnes souffrant de maladies mentales. Jean (prénom d’emprunt, comme pour tous les autres usagers dans cet article) anime la réunion presque à lui tout seul. Il veut écrire un article sur la page Facebook de la Charabiole et interpelle Stéphane pour qu’il explique son rôle en tant que pair-aidant. Ici, les usagers connaissent bien cette pratique. Même si Stéphane n’est arrivé que depuis le mois d’août au club psychosocial, ils ont déjà pu bénéficier auparavant de l’apport d’un ex-usager en santé mentale devenu pair-aidant.
Eric Faveaux, qui est aussi coordinateur de l’IHP, est en effet un convaincu de la première heure. Pour lui, le partage d’expérience entre «pairs» qui ont vécu une grande souffrance liée à des problèmes de santé mentale ou d’addictions est un «plus» pour des personnes qui se débattent encore dans ces difficultés. À la «Charabiole», explique Eric Faveaux, certains usagers souffrent de dépression, de bipolarité, de troubles schizophréniques, mais tous «cherchent à reprendre le pouvoir sur leur maladie, à vivre avec elle en vivant de la manière la plus autonome possible».
L’autonomie, il en est question dans le deuxième groupe de parole du vendredi. Presque les mêmes participants mais une autre approche. Ici, chacun arrive avec ses difficultés, ses aspirations, ses demandes d’aide. Une fois encore, le Covid et ses contraintes sanitaires s’invitent dans la discussion. Les activités du club (chant, guitare, jeux de société…) ont été réduites. Il n’est plus question de rester dans les locaux après celles-ci, de boire un café ensemble, d’y passer l’après-midi. Certains en souffrent et n’hésitent pas à le dire. «Quand ça ne va pas, ça fait du bien d’être avec d’autres personnes que soi», dit Laurent. Une jeune femme évoque, comme une plaisanterie, sa dépendance au chocolat, au sucre de manière générale, mais on sent bien que ce n’est pas vraiment drôle pour elle. Et voilà la gestion des médicaments, de l’alcool qui déboule dans les échanges. Stéphane intervient en évoquant la dépendance à l’alcool chez les personnes souffrant de bipolarité, l’alcool, cet ami-ennemi qui désinhibe ou console dans les épisodes dépressifs. «C’est difficile de s’en libérer», conclut-il. Plusieurs approuvent de la tête.
Nicole aborde Denis Collet, le psychologue-animateur, avec un problème bien précis. Elle veut quitter son habitation protégée, vivre en autonomie mais craint le refus du médecin psychiatre. Elle n’ose pas lui en parler. Dans le groupe, certains ont franchi ce cap et lui donnent des conseils tout en évoquant le côté face de l’autonomie tant désirée: la solitude. «Trouver l’énergie de se faire à manger rien que pour soi, ce n’est pas évident.» «Si tu cherches un appartement, ne dis surtout jamais que tu viens d’une IHP, s’exclame Amandine, car c’est comme une étiquette sur le front, celle d’un fou.» «Tu n’as pas peur que les voix reviennent?», s’inquiète Jean. Non, dit Nicole, «j’ai des médicaments et je me sens bien». La réunion se termine. Stéphane distribue des petits papiers en demandant aux participants d’écrire en un mot ce qu’est pour eux un pair-aidant. «J’ai cru longtemps que l’on parlait de ‘père aidant’», dit Jean. Cela fait rire tout le monde.