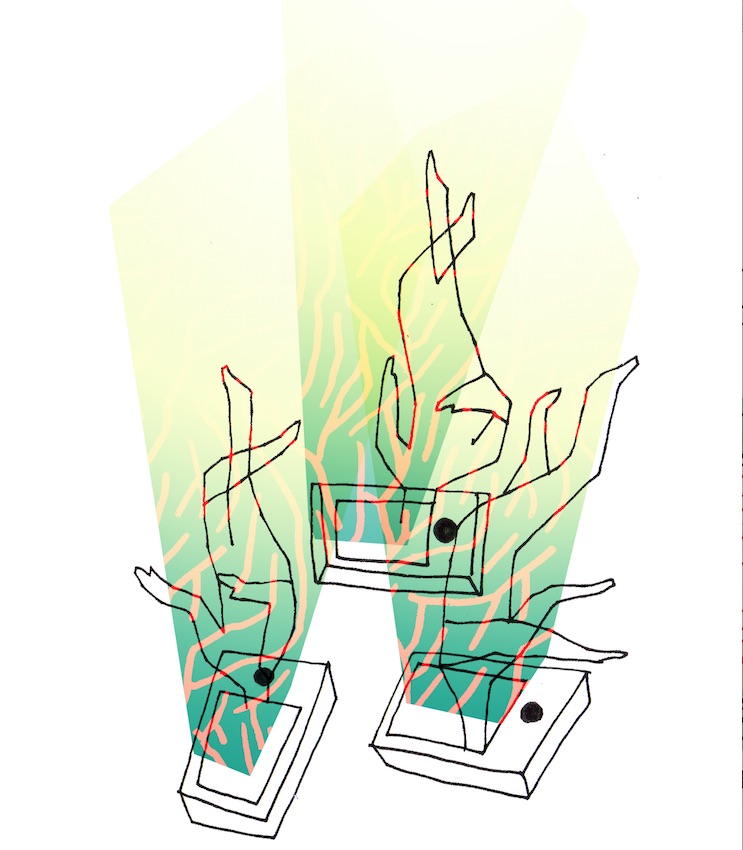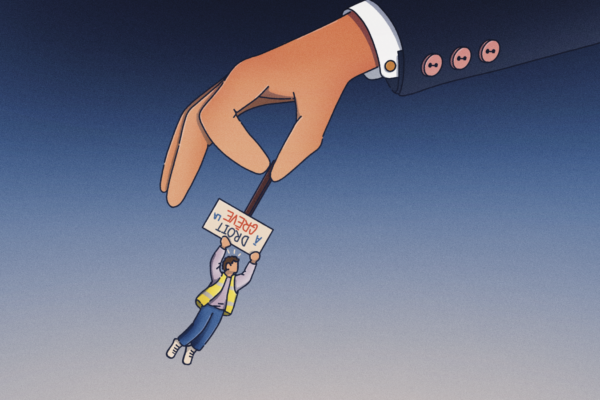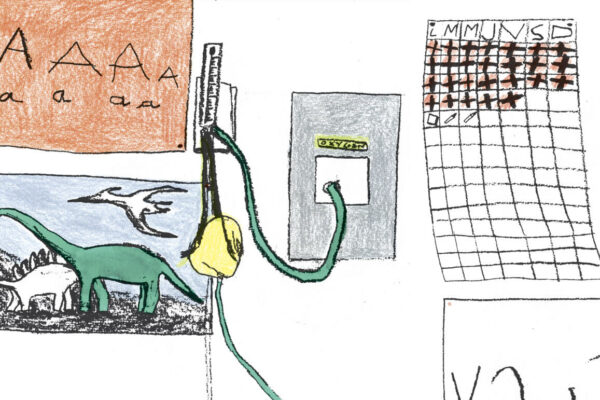«J’ai été soulagé d’être arrêté, je n’y serais pas arrivé tout seul.»
«Je n’aurais jamais osé parler de ça à qui que ce soit auparavant.»
«J’étais pris dans un engrenage.»
«J’ai besoin de comprendre pourquoi j’ai fait ça.»
«Je sais que j’aurai toujours besoin de ma thérapie pour ne pas risquer de recommencer.»
Les centres d’appui sont fondés sur des accords de coopération entre le ministre de la Justice et les trois Régions, qui se partagent une partie des compétences en matière de santé. Une sorte de délégation vers la santé, car la justice ne suffit pas pour prendre en charge les délinquants sexuels. «Il y a une punition, une sanction, une loi qui s’applique, mais il faut aussi éviter la récidive en prenant en charge ces auteurs de façon clinique», explique Michèle Janssens, directrice du Centre d’appui bruxellois (CAB). Les centres d’appui sont à la charnière de ces deux terrains de compétences.
Ils sont chargés de rendre différents types d’avis (avis motivé, d’orientation, de réévaluation) et ils agissent en fonction des situations judiciaires (alternative à la détention préventive, probation, surveillance électronique, libération conditionnelle, protection sociale…). L’enjeu diffère également selon que la personne est déjà incarcérée ou non. «C’est un travail au cas par cas, car la population est hétérogène et les situations sont complexes, précise Julien Lagneaux, directeur de l’Unité de psychopathologie légale (UPPL). La réalité judiciaire n’est pas toujours la réalité clinique et il y a un pas pour les patients entre la reconnaissance des faits reprochés et celle d’une problématique sexuelle ou autre.» Les objectifs du CAB et de l’UPPL sont notamment de vérifier la possibilité d’une guidance ou d’un traitement, de rechercher un point d’ancrage thérapeutique et de trouver chez l’auteur d’infraction(s) à caractère sexuel (AICS) ce qui est mobilisable pour un travail thérapeutique.
Aider le juge à prendre la décision la plus adaptée
Les principales autorités mandantes sont la commission de probation (pour les condamnés qui obtiennent un sursis probatoire), le tribunal de l’application des peines (pour les détenus en demande de libération conditionnelle ou sous surveillance électronique), la chambre de protection sociale (pour les internés, reconnus irresponsables au moment des faits délictueux, en demande de libération à l’essai ou définitive), le parquet ou le juge d’instruction (pour les personnes en détention préventive incarcérées ou libérées sous conditions). Quant aux interlocuteurs judiciaires les plus fréquents, il s’agit des assistants de justice (chargés du suivi judiciaire des justiciables extra-muros et du contrôle des conditions imposées par le juge), des équipes psychosociales des prisons et des centres psychiatriques spécialisés (chargées de la préparation à la sortie de prison), des secrétariats des chambres de protection sociale, des substituts et procureurs sollicitant des avis spécialisés.
Pour déterminer l’opportunité d’octroyer ou non une mesure probatoire, des psychologues évaluent l’AICS et rendent un avis motivé visant à évaluer la dangerosité, le risque de récidive et les facteurs qui y sont liés, et à déterminer si cette personne peut entrer en traitement ou suivre une guidance. «La première question que l’on se pose est celle-ci: est-ce qu’une thérapie est possible?, résume Aziz Harti, psychologue et sexologue au CAB. Nous donnons des informations aux autorités judiciaires, mais nous ne décidons pas à leur place.» Luca Carruana, psychologue à l’UPPL, abonde: «On sait que ce qui va être écrit va peser, mais ce n’est pas à nous trancher sur la véracité des faits. Nous apportons un éclairage sur la personnalité, sur la manière dont la personne fonctionne, sur les facteurs de risque, sur ce qui a concouru au passage à l’acte: les éléments sociaux, le système de référence de la personne, la manière dont elle a été élevée, ses antécédents éventuels. Le mode opératoire est aussi éclairant. Est-ce un fait isolé uniquement sexuel? Ou s’inscrit-il dans un ensemble d’autres délits? L’idée étant de prendre un peu de hauteur et d’éclairer l’ensemble de la situation pour aider le juge à prendre la décision la plus adaptée.»
Pour réaliser au mieux cette mission d’avis, la mise à disposition du dossier judiciaire par l’autorité mandate est indispensable. «C’est une importante dérogation au secret professionnel, souligne Michèle Janssens. Nous pouvons aussi transmettre le dossier judiciaire au thérapeute.» En effet, son travail n’a rien à voir avec une thérapie individuelle classique: il lui sera plus qu’utile de bien connaître les tenants et aboutissants de cette prise en charge contrainte. «Généralement, la personne qui a commis des faits de mœurs n’est pas très fière de ce qui s’est passé, explique Luca Carruana. Elle ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée, elle arrive dans un service qu’elle ne connaît pas. L’interlocuteur qu’elle va rencontrer sera-t-il capable d’entendre ce qui a été fait? Lui dire d’emblée que nous avons eu accès à l’ensemble de son dossier judiciaire, cela fait retomber les défenses: nous savons, nous pouvons en parler ensemble. L’AICS n’est pas dans nos bureaux pour être jugé mais pour essayer de comprendre et de trouver des solutions.»