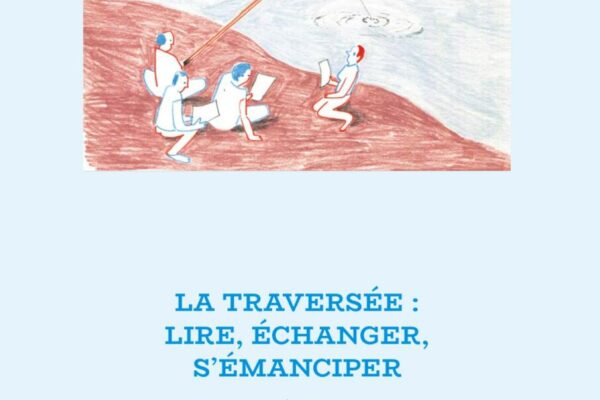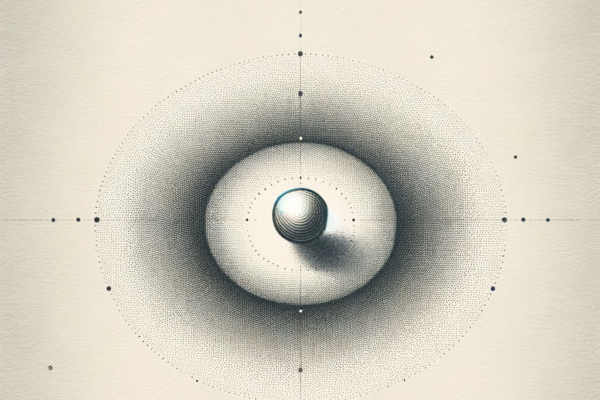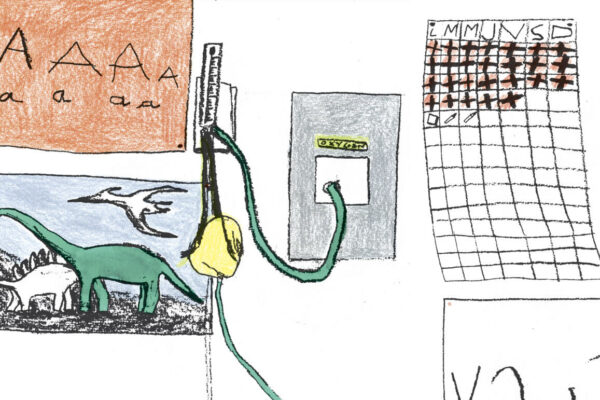Honoré Dolmen se réveille tous les jours avec la banane. Est-ce son tempérament qui le porte à voir la vie en rose ou sa bonne étoile qui l’a guidé vers le boulot de ses rêves, toujours est-il qu’il se dit «franchement passionné». Après avoir accompagné pendant huit ans des mineurs en danger ou en conflit avec la loi dans le cadre d’un COE (centre d’orientation éducative, aujourd’hui service d’accompagnement psycho-socio-éducatif [SAPSE]), il change d’emploi pour travailler dans ce qui allait devenir, un an plus tard, l’une des EMA de Bruxelles. «J’ai toujours eu une préférence pour le travail avec les ados en conflit avec la loi. Pour moi ce sont aussi des (ex-)mineurs en danger», résume-t-il. Ici, au sein de l’EMA, il peut aussi travailler «plus en profondeur» – il n’a «que» quatre jeunes à suivre en même temps – et de manière «plus autonome». «On a la possibilité, en fonction de nos aspirations, de nos connaissances et de nos compétences, de mettre sur le terrain ce dont on a envie. Ça m’a vraiment attiré.»
Tout comme Honoré, Julien Roebart, Valéry Dufour et Laura Cornet sont des professionnels résolument engagés. Au sein de l’EMA Bruxelles 1 (la capitale en compte trois) – pour les deux premiers –, de Mons-Tournai – pour les seconds –, ils apportent un suivi intensif à des jeunes à partir de 12 ans ayant commis des «faits qualifiés infractions» (FQI), sur mandat d’un juge de la jeunesse, alors qu’ils sortent tout juste d’une IPPJ ou justement pour leur éviter d’y entrer.
Au quotidien, ces accompagnants éducatifs jonglent avec les déboires et petites victoires de ces jeunes, avec leurs environnements familiaux, certes diversifiés, mais où se sont souvent noués des interactions en souffrance sinon de réels dysfonctionnements, ainsi qu’avec le tribunal de la jeunesse et les conditions qu’il a émises dans le cadre d’«une mesure d’intervention éducative dans son milieu de vie».
Au départ de l’intervention du tribunal, il y a un fait. Un fait «qualifié infraction» (FQI). De nature diverse, ces FQI entraînent des milliers de jeunes dans un face-à-face tendu avec la justice pour mineurs. Rien que pour 2020, on comptait 43.344 jeunes mis en cause dans les 70.000 nouvelles affaires entrées au cours de l’année au ministère public en Belgique (à l’exception du parquet d’Eupen)1. Toujours pour la même année, mais en Fédération Wallonie-Bruxelles cette fois, 1.693 jeunes dits «FQI» ont été pris en charge au moins un jour par les services publics – en gros, une IPPJ ou une EMA –, dont 522 par un service d’équipe mobile en milieu de vie. Un chiffre légèrement inférieur à 2018 et 2019 (années pour lesquelles on comptait entre 600 et 700 suivis), la pandémie ayant probablement entravé le travail des équipes au sein des familles2.
Face à des faits graves ou avec un risque de récidive élevé, l’IPPJ s’est révélée, des années durant, la réponse par excellence. Réaction «forte» vis-à-vis du jeune, «rassurante» pour l’opinion publique, cette institution – en régime ouvert ou fermé – entend protéger la société tout en proposant un axe éducatif visant la réinsertion sociale. Avec une grande limite: une fois la porte de sortie franchie, le jeune réintègre son milieu de vie au risque que le même refrain se répète obstinément, qu’il se joue et se rejoue jusqu’à l’âge de la majorité – et là, c’est une autre affaire.
Pour casser la spirale (souvent) infernale, il fallait donc agir sur ce milieu de vie. En 2002, les API – services d’accompagnement post-institutionnel – sont généralisés avec l’ambition de soutenir le jeune dans sa réinsertion dans la société après un séjour en IPPJ. En 2011, on crée les SAMIO – sections d’accompagnement, de mobilisation intensifs et d’observation –, qui se présentent comme une alternative à l’IPPJ et dont la mission consiste à accompagner le jeune dans l’exécution des mesures prises par le juge de la jeunesse. Quelques années plus tard, en 2019 – le «Code Madrane» est passé par là –, les deux services fusionnent et prennent l’appellation d’EMA, pour équipes mobiles d’accompagnement.
«Je crois réellement en cet outil, témoigne Johan Dessart, coordinateur de l’EMA de Bruxelles 1, qui a été éducateur en IPPJ puis à la SAMIO de Mons. En IPPJ, on était focus sur le jeune et pas sur son environnement extérieur. Dans ma pratique, cela me manquait très fort. Être au plus près du jeune et de son contexte de vie, cela permet de savoir poser un jeune face à qui il est vraiment, face à son identité.»
Sur papier, les objectifs des EMA consistent à amener le jeune à réfléchir au sens et aux impacts de ses faits, l’aider à satisfaire aux exigences fixées par le juge de la jeunesse, favoriser «l’émergence de conduites pro-sociales» ou encore «permettre au jeune d’acquérir une meilleure image de lui-même» en lui apportant du soutien pour «mobiliser ses ressources». Bref, un subtil mélange entre recadrage et émancipation, entre prévention de la récidive et valorisation du jeune dans ses projets de vie.
Dans la pratique, «il n’y a pas vraiment d’objectif de travail, explicite Valéry Dufour, de l’EMA de Mons-Tournai. L’objectif appartient au jeune, à ce qu’il veut faire de sa vie. On part de ce qu’il a envie d’être, comment il entrevoit son futur, et on est là pour le soutenir dans ses démarches». En d’autres termes, le but est que cet ado puisse devenir acteur de sa vie et responsable de ses choix. Et pour cela, pas de chemin tout tracé. «Les réponses, elles sont en eux, pas en nous. En général, ils savent très bien où ils en sont. La transgression est juste un symbole. Nous essayons d’amorcer une réflexion sur ‘comment faire autrement’. Nous sommes une boîte à outils», précise Marc Rombaux, coordinateur de l’EMA de Mons-Tournai.