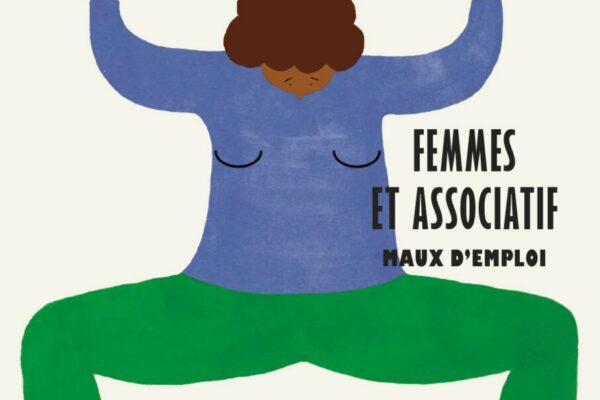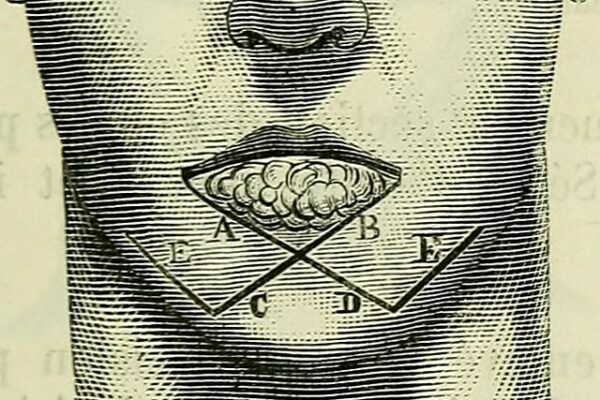Evelyne Dodeur est consultante et formatrice en gestion des ressources humaines (GRH). Spécialisée dans la sociocratie, elle nous livre son témoignage à propos de l’engouement actuel pour l’intelligence collective ou la sociocratie. Elle parle aussi des écueils qui attendent les équipes impliquées dans ce genre de démarche.
Alter Échos: Les nouveaux modes de gouvernance participatifs ont le vent en poupe. Particulièrement la sociocratie, dans laquelle vous êtes spécialisée. Comment expliquez-vous ce phénomène?
Evelyne Dodeur: Tout d’abord, je voudrais dire que je ne me sens pas partie prenante d’un phénomène de mode. Il s’agit pour moi de quelque chose de cohérent qui part d’un constat simple: quand les prises de décision dans une organisation sont descendantes, les gens ne les appliquent pas, ou à moitié. On traîne des boulets, beaucoup de monde n’est pas content. Il faut que les travailleurs soient plus concernés, investis. Il faut qu’ils prennent une part de responsabilité, qu’ils récupèrent un pouvoir d’action.
A.É.: Pourquoi?
E.D.: Parce que ça renforce l’efficacité. Tout part du fait de dire que l’intelligence collective, ça existe. L’idée est donc de profiter un maximum de cette intelligence collective et de se donner les moyens de la faire émerger. La sociocratie peut favoriser cela. Le contexte actuel est plus en plus complexe, cela bouge tout le temps. Il faut forcément avoir plusieurs têtes, plusieurs types d’intelligence autour de la table pour y parvenir. C’est une manière d’aborder la complexité du monde.
A.É.: Selon vous, la gestion traditionnelle de type vertical n’est plus adaptée aux travailleurs actuels?
E.D.: Il y a probablement une évolution due à la fameuse «génération Y». Elle est composée de gens qui ont envie d’être impliqués, de prendre une part de responsabilité, d’être consultés. Cela dit, attention: la sociocratie va très loin dans la prise de responsabilité et dans le partage du pouvoir. Et ça, je ne suis pas certaine que les boîtes qui se lancent dans l’aventure soient toujours bien conscientes de ce que ça implique.
A.É.: Et cela implique quoi?
E.D.: Ce ne sont pas juste des outils et un mode de gouvernance. Si vous lisez la théorie, ce n’est quand même pas extraordinaire, ce n’est pas la révolution. Si vous prenez les quatre grands principes de la sociocratie (voir encadré) et que vous les appliquez sans changer votre façon d’être, il ne se passe rien. Ou pire, ça ne fait que renforcer ce qui se passe déjà dans la structure. Le changement fondamental, il est aussi dans l’esprit. C’est une autre manière d’être ensemble. Les gens vivent dans une société de la peur et de la méfiance. Alors que la sociocratie mais aussi d’autres modes de gouvernance vont complètement à contre-courant. Il faut être dans la confiance et la bienveillance. Il y a un grand lâcher-prise. II faut une capacité à faire confiance et à construire cette confiance réciproque. Cela nécessite des collectifs qui soient forts, matures, responsables. Le pouvoir n’est plus centralisé sur la tête d’une ou deux personnes, la décision est collective. Et on partage les responsabilités qui vont avec.
A.É.: Certaines directions, et certains membres du personnel, ne sont pas toujours prêtes à cela?
E.D.: Oui, ou ils ne sont pas conscients de ce que ça implique, comme je l’ai dit. Donner son avis, c’est une chose. Mais prendre une part de responsabilité, c’est une autre. Certaines se plaignent du fait qu’on ne leur demande jamais leur avis. Mais quand on leur en donne l’occasion, ils se réfugient dans une attitude du type «C’est pas moi qui décide». Certains ont peur. Sans généraliser, il s’agit souvent de personnes moins qualifiées, qui officient dans des postes moins reconnus. Ils disent «Voilà 20 ans que je travaille, je suis à deux ans de ma pension, on ne m’a jamais demandé mon avis et maintenant je dois le donner?».
A.É.: C’est une question d’image de soi en quelque sorte.
E.D.: Oui. Beaucoup de gens affirment qu’ils n’ont rien à dire. Et puis quand ils ouvrent la bouche, c’est en général extrêmement pertinent. De nouveau, c’est une question de confiance: chacun, quel que soit son niveau d’études, de compétence, a quelque chose à apporter.
A.É.: Il faut que les gens soient aussi capables d’être partie prenante…
E.D.: Oui, et capables de lâcher du lest. Certains chicanent sur des détails et c’est là qu’il faut grandir en maturité. Dans une prise de décision traditionnelle, on va se cristalliser sur deux propositions: A ou B. Et on va mettre toute notre énergie à argumenter pour faire céder la partie adverse. Dans la démarche qui nous intéresse, c’est complètement différent. On va essayer de faire fusionner A et B, mettre toute notre énergie dans la recherche de solutions qui prennent en considération les deux parties.
A.É.: Est-ce que ça n’est pas un lieu commun? Est-ce que ce n’est pas censé être comme ça tout le temps, même sans nouveau mode de gouvernance ou sociocratie?
E.D.: Oui, mais dans les faits cela se passe rarement comme ça. C’est comme dans un couple: il y en a souvent un qui se couche, l’autre prend le pouvoir et puis au bout d’un moment, on pète un câble…
A.É.: Comment est-ce qu’on travaille cette démarche d’intelligence collective?
E.D.: Je pense que pour soutenir un collectif qui veut se lancer, il faut une personne extérieure. Les gens n’ont pas une conscience permanente de ce qui est en train de se jouer. Il faut leur apprendre à faire du méta régulièrement: comment cette réunion s’est-elle passée? Est-ce qu’on a respecté le tour de parole? Est-ce que chacun a pu prendre sa place? Est-ce qu’on s’est enlisé dans des prises de position sans essayer de construire quelque chose de différent? Il s’agit de mettre en lumière les fonctionnements collectifs et individuels.
A.É.: En général ça marche?
E.D.: Oui, tant que je suis là. Après on revient avec les vieilles habitudes. C’est un vrai défi d’autonomiser une équipe là-dessus. Les gens savent que quelque chose ne s’est pas bien passé, mais ils ne savent pas comment agir autrement, comment déjouer cela.
A.É.: C’est une limite de la démarche?
E.D.: Je ne crois pas. Pour moi, il existe d’autres limites. Le temps tout d’abord. Il faut que les gens sachent que ça va prendre du temps. Au début, il faut de la patience. Il y a aussi la question de l’argent. Il faut former l’équipe et cela a un coût. Enfin, il faut aussi une hiérarchie qui accepte de partager le pouvoir. C’est souvent elle qui met en œuvre la démarche et puis elle fait marche arrière. C’est un système qui met aussi les conflits au jour, on peut perdre des gens dans l’aventure. Cela dit, les structures qui dysfonctionnent perdent déjà des gens…
A.É.: Qu’est-ce qu’on fait avec les travailleurs réticents? On ne peut quand même pas les virer?
E.D.: Chaque cercle peut décider de ce qu’il va faire avec ça. Et cela peut être très varié d’un cercle à un autre. C’est à lui de se poser la question: comment aménage-t-on notre fonctionnement pour laisser tel ou tel travaill
eur à un poste d’observation s’il n’a pas envie de participer. Qu’est-ce qu’on est prêt à accepter et à tolérer? Et si ça ne va pas à l’encontre de l’accomplissement de notre mission en tant que cercle, ça peut ne pas être un souci. On peut trouver des aménagements, c’est la popote du cercle. Mais si cela pose problème, il faut trouver le courage de remettre ça sur la table…
A.É.: Un groupe d’humains peut être collectivement très violent. Ce n’est pas un peu dur de mettre quelqu’un «dehors»?
E.D.: Il peut y avoir des phénomènes d’inclusion, on engage un nouveau collaborateur. Ou bien des processus d’exclusion du cercle. Quand c’est bien fait, la personne qui ne parvient pas à adhérer au fonctionnement du collectif finit par dire «Je m’en vais». Cela dit, je pense que souvent la violence est déjà là. Quand un travailleur est sur la touche, qu’on lui dit à peine bonjour le matin, qu’on l’ignore, quand on ne lui donne rien à faire parce qu’on pense qu’il n’est pas compétent, c’est de la violence. Mais oui, le fait qu’une personne soit exclue d’un cercle ça peut être dur. Plein de choses sont inconfortables dans la sociocratie puisqu’on dit les choses.
A.É.: Est-ce qu’il y a une limite d’échelle au modèle?
E.D.: Les grosses boîtes qui l’utilisent comptent 2.000 ou 3.000 personnes. Il n’y a pas de limite. Par contre, il existe une limite au nombre de personnes présentes dans un cercle. Dans les groupes qui débutent, au-delà de 15, cela devient fastidieux. Quand on est bien rodé, on peut aller jusqu’à 20 ou 25. Quant à la sociocratie à l’échelle d’une ville, j’en rêve. Quand je vois les débats où on passe son temps à s’engueuler et à convaincre l’autre, ça n’a pas de sens. Cette énergie est gaspillée inutilement.
A.É.: Avant ça, il faudra peut-être faire le tri entre la sociocratie et d’autres modèles de nouvelle gouvernance. Il existe une «guerre d’écoles» entre ces différents modèles… comme en psychologie?
E.D.: Oui.
A.É.: C’est un milieu qui se parle, se rencontre?
E.D.: Oui, des colloques sont organisés. Et là il existe parfois un paradoxe. Les gens parlent beaucoup, sans trop s’écouter. On n’est plus vraiment dans l’esprit de ce que l’on défend…
La sociocratie est basée sur quatre principes:
Le consentement
En sociocratie, une décision est prise par consentement s’il n’y a aucune objection importante et argumentée qui lui est opposée. Concernant le processus de discussion, Evelyne Dodeur explique. «Dans un premier temps, on peut faire du remue-méninges, quelque chose de moins structuré. On confie ensuite la responsabilité à quelqu’un de rédiger une proposition au moyen de la matière qui en est ressortie. Et puis dans un troisième temps, le groupe décide sur la base de cette proposition. Il ne remet pas la proposition en cause, il ne fait que la bonifier.»
Les cercles
La structure de décision de l’organisation est parallèle à sa structure fonctionnelle. À chaque élément de celle-ci correspond un cercle. Les cercles sont connectés entre eux et organisent leur fonctionnement en utilisant la règle du consentement. Tous les membres de l’organisation appartiennent à au moins un cercle.
Chaque cercle est notamment responsable de la définition de sa mission, sa vision et ses objectifs, de l’organisation de son fonctionnement en cohérence avec la stratégie définie par le cercle de niveau supérieur.
Le double lien
Un cercle est relié au cercle de niveau immédiatement supérieur par deux personnes distinctes qui participent pleinement aux deux cercles. L’une est élue par le cercle de «niveau inférieur» et le représente; l’autre est désignée par le cercle de niveau supérieur et est le leader fonctionnel du cercle.
L’élection sans candidat
Quand il s’agit de choisir une personne pour occuper une fonction, un cercle sociocratique procède à une discussion ouverte et argumentée aboutissant à une nomination par consentement. «Personne n’est candidat, tout le monde est potentiellement éligible. Tout le monde vote et puis, de manière transparente, vous devez dire pourquoi vous avez voté pour telle ou telle personne. Et vous devez dire quelles sont ses qualités», explique Evelyne Dodeur.
Source: www.sociocratie.net
Aller plus loin
Alter Échos du 28.09.2015 :«Pensez comme une forêt»
Alter Échos du 28.09.2015 : Holacratie, la marque de l’émancipation
Alter Échos du 28.09.2015 : Crouzet, entreprise libérée
Alter Échos du 28.09.2015 : La participation dans le ventre
Alter Échos du 28.09.2015 : SPF mobilité : vers la libération ?
Alter Échos du 28.09.2015 : Dans les maisons médicales, on cultive l’autogestion